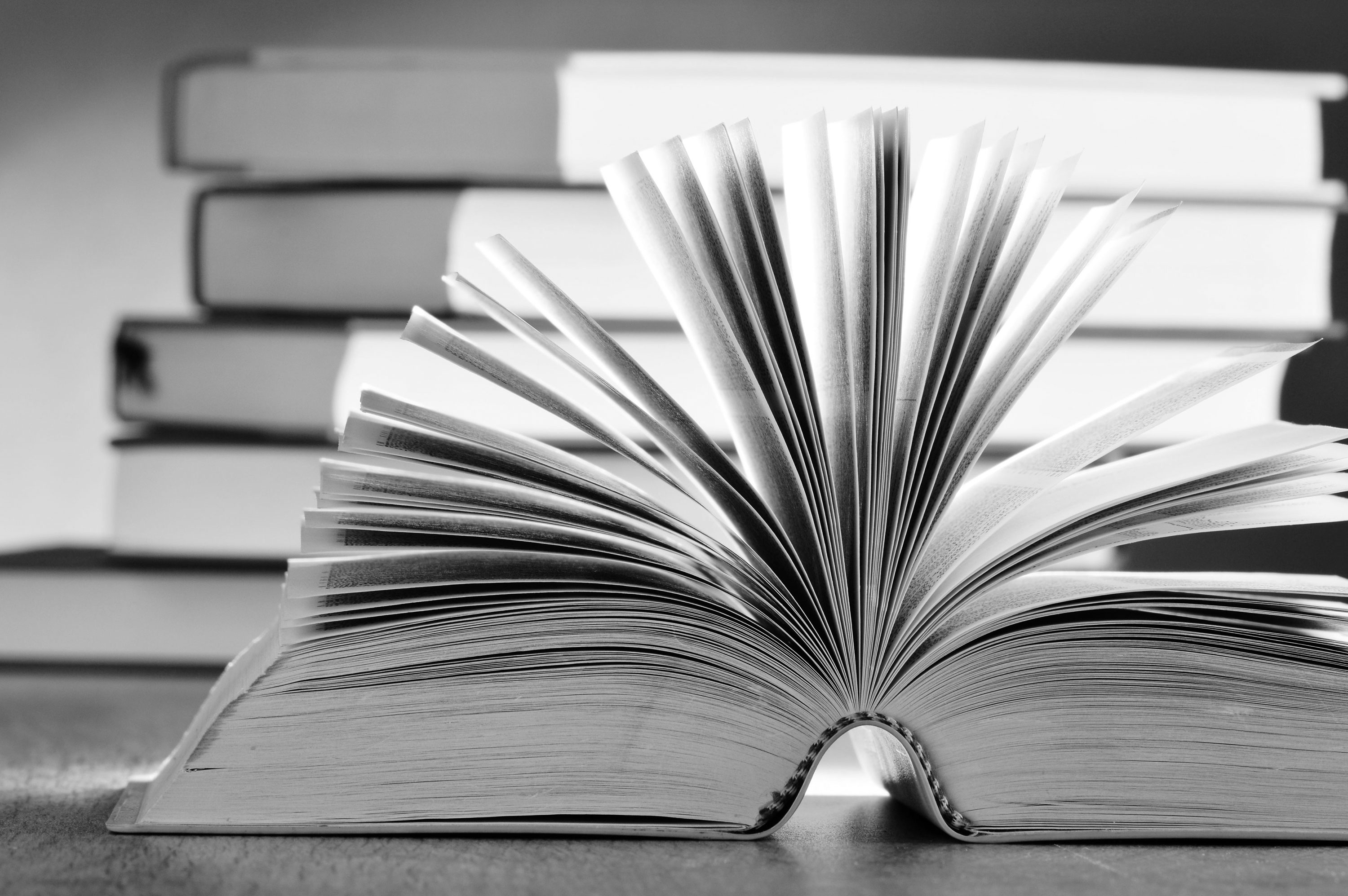
Thématique Violence
- Violence domestique
Si vous n’êtes pas en présence d’une situation de violence aiguë, mais que vous vivez dans une relation où vous vous sentez restreint dans vos libertés, si vous n’arrivez pas à faire face à votre partenaire ou que les conflits prédominent, parlez-en ! Contactez une personne de confiance ou un centre de consultation. Osez briser le silence, vous avez droit à une relation sans violence ! Il y a dans tous les cantons des offices de consultation conjugale (également ouverts aux couples non mariés) dont vous trouverez facilement les adresses sur Internet.
Il existe dans chaque canton des centres de consultation pour l’aide aux victimes, ouverts gratuitement aux personnes touchées, indépendamment de leur âge et de leur sexe. Le soutien fourni englobe les soins médicaux, le conseil juridique, et le soutien thérapeutique ou encore l’aide matérielle. La consultation est confidentielle et anonyme, si la personne le souhaite. Les proches et la famille peuvent aussi solliciter conseil et soutien. Nul besoin qu’une procédure pénale soit ouverte pour avoir droit à cette aide. Les collaborateurs des centres de consultation sont tenus au secret de fonction. Seulement dès lors que l’intégrité corporelle, psychique ou sexuelle d’une personne mineure ou placée sous tutelle est menacée, le centre de consultation peut prévenir l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) ou déposer une plainte.
Les maisons d’accueil pour femmes sont des lieux d’intervention en cas de crise : elles sont destinées aux victimes de violence et à leurs enfants qui, face à une situation de violence aiguë, ont immédiatement besoin de protection, d’hébergement et de conseils. Les nouvelles dispositions légales permettent d’expulser les personnes violentes du domicile et de faire en sorte que les victimes et leurs enfants puissent rester ensemble dans leur environnement habituel. Toutefois, de nombreuses femmes considèrent un séjour dans une maison d’accueil pour femmes comme l’unique moyen de retrouver la sécurité. Souvent il s’agit pour un certain temps de l’unique issue pour les femmes dépourvues de réseau social ou soumises à une menace diffuse. Cette période doit permettre aux intéressées de retrouver calme et sécurité et de bénéficier du conseil de spécialistes pour élaborer une solution adéquate.
Certains cantons disposent d’hébergements pour les hommes victimes de violence.
Les offres de conseil pour hommes sont regroupées sous www.maenner.ch. Aux pages pharos-geneve.ch et zwueschehalt.ch, vous trouverez des contacts de maisons d’accueil pour hommes de Suisse.
Souvent, les personnes violentes souffrent elles aussi des conséquences de leurs actes, qu’elles sont incapables d’anticiper et de contrôler. Elles doivent néanmoins en assumer la responsabilité et apprendre à se maîtriser.
L’association professionnelle suisse de consultations contre la violence (APSCV) tient sur son site www.apscv.ch un registre d’adresses de centres de conseil et de programmes d’apprentissage par région.
La violence physique est la forme de violence la plus manifeste et englobe différents actes d’agression pouvant aller jusqu’à entraîner la mort.
La violence sexuelle, quant à elle, désigne des actes relevant du harcèlement ou de la contrainte sexuels pouvant aller jusqu’au viol.
Les autorités de poursuite pénale sont aussi confrontées à la violence psychique, moins visible, alors même que les souffrances causées aux victimes ne sont pas moindres. La violence psychique comprend entre autres les insultes, les intimidations, les humiliations ou encore les comportements jaloux. La plupart de ces formes étant passibles de sanctions, on peut porter plainte en invoquant des menaces graves, la contrainte, la privation de liberté, le harcèlement obsessionnel du partenaire après une séparation (stalking).
La violence économique est une autre forme de violence qui va de la privation d’argent ou la saisie du salaire, l’abus de confiance, l’interdiction de travailler au travail forcé ou la détention par un seul partenaire du pouvoir de décision concernant les ressources financières. L’auteur·e rend ainsi la victime dépendante de lui ou d’elle.
Outre ces quatre formes, la violence domestique englobe aussi des comportements qui ont tous pour but d’exercer un contrôle sur la victime et de restreindre ou de réprimer son libre arbitre.
La violence domestique s’exerce le plus souvent dans des relations entre adultes, indépedamment de leur orientation sexuelle, et peuvent impliquer des enfants. Mais il existe encore bien d’autres types de relations qui, en cas de violence, tombent également dans le champ de définition de la violence domestique. Quelques exemples : la violence dans les relations de couple entre jeunes gens ; le mariage forcé et la violence entre époux mariés sous la contrainte, les crimes dits d’honneur, les mutilations génitales, la violence envers les personnes âgées dans le cadre familial, la violence des parents envers leurs enfants et inversement, la violence entre frères et sœurs ou encore le harcèlement obsessionnel (stalking).
Ici également, les centres de consultation pour l’aide aux victimes peuvent apporter un soutien ou vous orienter vers des offres spécifiques d’aide et de soutien.
Le Code pénal (CP) stipule que les lésions corporelles simples (art. 123, ch. 2, al. 3 à 5 CP), les voies de fait réitérées (art. 126, al. 2, let. b, bbis et c CP), les menaces (art. 180, al. 2 CP), l’atteinte et la contrainte sexuelles (art. 189 CP) et le viol (art. 190 CP) entre conjoints ou partenaires doivent être poursuivis d’office. Les actes de violence sont poursuivis d’office lorsqu’ils sont commis entre conjoints ou entre partenaires, indépendamment de leur orientation sexuelle, faisant ménage commun pour une durée indéterminée et pendant un an après la séparation. Les actes de violence entre conjoints sont poursuivis d’office même si les époux ont chacun un domicile ou vivent séparés, et pendant un an après le divorce.
Si une violence a été exercée ou que des menaces graves ont été proférées et que les victimes continuent de vivre sous la menace de la personne violente, la police peut ordonner des mesures immédiates comme l’expulsion de celle-ci et une interdiction de revenir dans le logement. Ainsi, les victimes, en général des femmes et des enfants, peuvent rester dans leur logement.
L’expulsion du logement ordonnée par la police est limitée dans le temps. Cette durée varie de 10 à 20 jours selon les cantons. Les tribunaux civils ou d’autres autorités judiciaires sont compétents pour ordonner l’éloignement des auteur·es des victimes. Ces instances peuvent notamment ordonner : l’attribution du domicile conjugal à la victime et à ses enfants pour utilisation exclusive pendant la séparation ; l’interdiction de contacts (personnels, par téléphone, SMS, courriel, lettre) ainsi qu’une interdiction de s’approcher (rue, quartier, école, etc.).Si une interdiction de contact est prononcée, il est interdit à la personne à l’origine du danger d’entrer en contact sous quelque forme que ce soit avec la personne en danger. L’interdiction comprend notamment l’interpellation directe, les appels téléphoniques, les SMS, les courriels, les lettres, Facebook, etc. Si la protection l’exige, l’interdiction de contact peut aussi être étendue à d’autres personnes, par exemple, enfants ou proches.
La police a sa ligne d’urgence au 117, ouverte 24h sur 24, que l’on peut appeler en cas de menace ou de danger aigus. Aigu ne signifie pas qu’il faille attendre le dernier moment ! Mieux vaut lancer un appel trop tôt que trop tard.
Le travail de la police donne la priorité à la protection des victimes, avant de s’occuper de l’auteur·e. Idéalement, l’intervention se présente comme suit : la police s’informe sur place auprès des victimes. Elle les interroge hors de la présence de la personne présumée coupable de violence pour établir s’il y a eu infraction au code pénal. S’il y a des traces de blessures, la victime est escortée en un lieu où elle pourra recevoir des soins. Les personnes concernées sont averties des actions en justice qu’elles peuvent intenter et sont interrogées par une personne du même sexe. S’agissant d’enfants, il est veillé à ce qu’ils soient traités et informés en adéquation avec leur âge ; si besoin est, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) est avertie. Si une violence a été exercée ou que des menaces graves ont été proférées, la police examine l’éventualité d’expulser la personne violente ou de lui interdire de s’approcher. Cette mesure permet aux victimes, qui sont souvent des femmes et des enfants, de ne pas quitter leur domicile.
En cas d’urgence majeure, appelez la police au 117. Ne vous exposez pas en intervenant.
Expliquez aux personnes concernées que la violence dans la sphère privée n’est pas un problème privé. Rappelez-lui qu’en Suisse il existe des lois protégeant les victimes et que des centres de consultation sont là pour les aider.
Offrez spontanément votre aide (écoute, hébergement en cas d’urgence). Mais soyez patients ; il se peut que l’on décline votre offre dans un premier temps.
Collectez des informations sur l’aide professionnelle destinée aux victimes et aux auteur·es de violence ; remettez-les à la personne concernée.
Quand on aborde la question de la fréquence, il s’agit de distinguer entre ce qui s’est passé réellement et ce que les autorités (polices, organismes d’aide aux victimes, etc.) en savent.
Le fait est que la police est appelée à intervenir plusieurs milliers de fois par an en raison de conflits et d’actes de violence surgissant dans le contexte familial ou dans une relation de couple. Dans ce contexte, dès qu’une infraction potentielle est portée à la connaissance de l’autorité de poursuite pénale à la suite d’une intervention policière, une enquête est ouverte, sans qu’il faille une plainte formelle de la victime. On estime que seuls 20% des cas de violence domestique sont portés à la connaissance de l’autorité. L’ampleur effective du phénomène serait donc cinq fois plus importante que ne le laissent supposer les cas recensés. Néanmoins, la police a le plus souvent connaissance des infractions graves.
Chaque année en Suisse, on déplore entre 20 et 30 décès dus à la violence domestique ; rapporté à l’ensemble des homicides commis dans notre pays, la proportion est de 40 à 50 %. À cela s’ajoutent entre 40 et 60 tentatives de meurtre dans la sphère domestique.
Les dénonciations pour délits de violence domestique sont publiées chaque année par l’Office fédéral de la statistique.
Les enfants qui font l’expérience de la violence entre leurs parents ou référents proches sont toujours des victimes de violence psychique. On sait par ailleurs que ces enfants ou adolescent·es subissent aussi en très grande majorité des abus, que ce soit de la maltraitance physique ou psychique ou de la négligence. Les enfants qui grandissent dans un système familial empreint de violence ont des séquelles et ont besoin qu’on leur apporte une protection particulière. L’expérience de la violence vécue à la maison représente aussi pour l’enfant un facteur de risque, qui pourrait le rendre, dans sa vie future d’adulte, victime ou auteur de violence.
Après une intervention dans laquelle étaient impliqués des enfants et des adolescent·es, la police informe l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA). Cette dernière est compétente pour évaluer la situation et prendre, le cas échéant, des mesures de protection pour les enfants.
Les jeunes mineurs peuvent aussi faire appel aux offres de l’aide aux victimes et y recevoir soutien et conseils ciblés. Dès lors que l’intégrité corporelle, psychique ou sexuelle d’une personne mineure ou placée sous tutelle est menacée, le centre de consultation peut prévenir l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) ou déposer une plainte.
Les migrantes et les migrants vivent souvent dans des conditions qui augmenteraient pour chacun de nous le risque d’exposition à la violence domestique : souvent, les femmes se sont mariées jeunes et ne sont pas dans une situation financière avantageuse, le logement familial est exigu, les situations professionnelles précaires ne sont pas rares et le tissu social est distendu. De plus, beaucoup de migrantes et de migrants ont été victimes de violence, par ex. lors de la fuite de leur pays, ou en ont été les spectateurs involontaires.
Se séparer si l’union a été de courte durée peut contraindre une personne dépendante du droit de séjour de son conjoint ou de sa conjointe à quitter la Suisse. La violence subie peut être un motif opposable pour obtenir le droit de rester en Suisse.
Les obstacles juridiques peuvent donc retenir les personnes étrangères victimes de violence domestique de recourir aux offres d’aide et soutien proposées en Suisse.
Mariages précoces, problèmes financiers, conditions de logement défavorables, chômage et faible statut social sont autant de facteurs qui augmentent non seulement le risque de devenir victimes, mais aussi auteur·s de violences domestiques. Par ailleurs, les victimes et les auteur·s issus de la migration ont rarement connaissance des offres de soutien et ne peuvent guère compter sur un soutien dans leur environnement social.
- Violence des jeunes
La violence des jeunes peut revêtir toutes sortes de formes : psychique et verbale (par ex. mobbing), physique et sexuelle (bagarres, harcèlement sexuel), agressions, voire meurtre ou homicide. Les actes de violence peuvent viser des personnes, des animaux ou des choses (des actes de vandalisme par exemple). En général, lorsque l’on parle de violence juvénile, on ne fait pas de distinction entre les actes commis par de jeunes adultes (de 18 à 25 ans) ou des mineurs (jusqu’à 17 ans). Mais la justice n’intervient pas de la même manière pour les délits commis par des mineurs. En effet, le droit pénal des mineurs vise davantage la resocialisation des délinquants que la punition pour leurs actes.
Les enfants et les jeunes qui ont entre 10 et 18 ans sont soumis au droit pénal des mineurs, divisé en droit pénal des mineurs (DPMin) et en procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin). Les enfants sont donc pénalement responsables dès l’âge de 10 ans et peuvent être poursuivis pour leurs actes à partir de cet âge. La majorité ou responsabilité pénale est l’âge dès lequel on peut être puni pour un acte que la loi sanctionne d’une peine. Si les parents ne parviennent pas à prendre les mesures qui s’imposent avec leurs enfants lorsque ceux-ci ont moins de 10 ans et que leur comportement outrepasse certaines limites, c’est l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) qui prend le relais et ordonne des mesures.
En Suisse, l’objectif premier du droit pénal des mineurs est de protéger et de rééduquer les jeunes ainsi que de les empêcher de commettre à nouveau des délits, pendant qu’ils sont encore mineurs ou plus tard à l’âge adulte. Il est primordial que les peines soient appliquées rapidement après les délits et qu’elles soient équitables si l’on veut que la resocialisation soit couronnée de succès. Pour cette raison, la procédure pénale est toujours accompagnée de discussions sur la situation personnelle, familiale, scolaire ou professionnelle d’un jeune ainsi que sur ses loisirs. Indépendamment de la question de savoir quelle mesure, éducative ou thérapeutique, sera ordonnée (p. ex. traitement ambulatoire ou placement dans un foyer), ou s’il s’agit d’une punition (p. ex. privation de liberté, amende, réprimande), celle-ci devra être exactement adaptée à l’auteur du délit et avoir un effet éducatif et préventif afin d’empêcher d’autres délits dans la mesure du possible.
Il n’est fait aucune distinction dans le droit pénal des mineurs et celui des adultes en ce qui concerne le caractère punissable des délits. En clair, ce qui est interdit pour les adultes l’est également pour les jeunes.
Certains corps de police ont créé des services de la jeunesse qui s’occupent d’élucider certains délits typiques des jeunes ainsi que d’intervenir et de prévenir. Vous trouverez ici une vue d’ensemble des services de police.
Les mesures de politique sociale peuvent aussi avoir un effet préventif contre la violence, par exemple si les compétences sociales des jeunes s’en trouvent renforcées. Elles sont appliquées directement dans le travail avec les jeunes ou indirectement dans des environnements déterminés (groupe de jeunes, famille et école, p. ex.). En même temps, les mesures pour l’amélioration de conditions-cadres structurelles (logement et quartier, aide à l’insertion professionnelle et à l’intégration) contribuent beaucoup à la prévention de la violence. Ainsi, des politiques ciblées et effectives d’intégration ou de formation ont toujours un effet préventif de la criminalité.
L’identification et l’intervention précoces sont primordiales dans la prévention de la violence chez les jeunes. À l’origine, c’est pour la prévention des toxicomanies que des stratégies d’identification et d’intervention précoces avaient été mises en place. Aujourd’hui, elles sont reprises dans d’autres contextes, en particulier celui de la violence. Ce qu’il faut retenir, c’est que les interventions ne devraient pas uniquement viser la réduction des risques mais aussi le renforcement de l’individu et de ses ressources.
- Tout au long du développement de l’enfant, la famille assure aussi un rôle essentiel dans la prévention de la violence. À cela, il y a deux raisons : la première, c’est que les facteurs de risque familiaux participent à l’apparition de problèmes comportementaux dans l’enfance et l’adolescence ; la seconde, c’est que la sollicitude des parents est indispensable pour un développement émotionnel et social harmonieux de l’enfant.
- Une prévention ciblant la famille a pour but d’aider les parents à apporter à leur enfant tout au long des phases de sa vie jusqu’à l’âge adulte un soutien au développement de ses compétences linguistiques, sociales, corporelles, cognitives, émotionnelles, morales et artistiques. D’autre part, des méthodes d’éducation dysfonctionnelles ou qui renforcent les comportements agressifs et conflictuels sont ainsi évitées. En Suisse, les mesures de prévention ciblant la famille sont mises en œuvre aussi bien par des acteurs publics que privés.
- Enfin, des mesures ordonnées par les autorités sont également mises en place lorsque des problèmes sont constatés. Il peut s’agir de cours obligatoires pour les parents, d’accompagnements obligatoires de, familles (assistance sociopédagogique, soutien dans les compétences, etc.) ou encore de placements d’enfants dans des familles d’accueil. De telles mesures sont en général prononcées par l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA).
- Mais la prévention de la violence dans la famille ne s’adresse pas seulement aux parents, aux grands-parents et à d’autres personnes qui s’occupent des enfants mais également aux enfants et aux jeunes eux-mêmes. On citera à cet égard notamment les mesures contre la violence dans les relations amoureuses entre jeunes ou encore la violence exercée par des jeunes contre leurs parents, leurs frères et sœurs et leurs grands-parents.
Les enfants passent beaucoup de temps à l’école. Leur qualité de vie et leur comportement sont ainsi grandement influencés par leurs relations avec leurs camarades et leurs enseignants. L’école joue donc un rôle important pour le développement social des élèves. Mais elle est aussi un lieu dans lequel on assiste à toutes sortes de formes de violence. Il est donc du devoir des écoles de la prévenir. Pour agir préventivement contre la violence, les points suivants sont à prendre en considération :
- L’encouragement d’un environnement positif pour tous les acteurs de l’école constitue la base de la réussite d’une mise en œuvre des mesures de prévention. Il existe de nombreuses possibilités pour faire de l’école un lieu de convivialité harmonieuse : améliorer le climat dans l’établissement, fixer des règles et des sanctions claires, élaborer une charte ou des structures participatives.
- L’intervention rapide et ciblée en cas de comportements problématiques, par exemple les intimidations et les brimades ou les absences injustifiées, devrait également donner lieu à des mesures participant d’une stratégie de prévention intégrale dans les écoles.
- La formation des enseignants est un élément important de la prévention de la violence. Ils doivent notamment être sensibilisés aux nouvelles formes de violence telles que l’intimidation en ligne ainsi qu’aux processus de l’intervention précoce.
- La collaboration avec les parents est fondamentale. Les parents sont les premiers responsables de l’éducation de leurs enfants et doivent, à ce titre, être impliqués dans tout projet de prévention et d’intervention.
- En cas d’événements graves, une stratégie d’intervention pour les situations de crise permet de réagir de façon adéquate avec les bons partenaires et les bonnes ressources. La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) a publié un guide sur la question qui sert de base pour une stratégie.
Pour les petits, c’est surtout la famille, plus tard l’école pour les jeunes enfants, qui constituent les principaux lieux d’apprentissage et de vie. Puis l’horizon s’étend peu à peu au voisinage et à l’espace public entre la puberté et l’adolescence. Avec cette extension, ce sont tous les facteurs de protection et de risque qui évoluent pour les comportements de violence. La consommation d’alcool et de drogues, les activités de loisirs non structurées, les sorties nocturnes fréquentes, un contrôle social réduit au minimum, un cercle d’amis délinquants et des quartiers à problèmes deviennent alors des éléments susceptibles de favoriser un comportement violent.
La prévention de la violence passe aussi par l’aménagement d’espaces publics disponibles, par la création d’offres de loisirs ainsi que par la possibilité pour les jeunes ayant des problèmes de consulter des spécialistes. Le succès des stratégies de prévention de la violence juvénile passe par une combinaison de mesures préventives et de mesures d’intervention et d’ordre adaptées. Il existe aujourd’hui en Suisse un bon nombre de mesures qui ont fait leurs preuves, par exemple : l’encouragement au développement de quartiers ; les activités de loisirs aisément accessibles ; la prévention de la violence dans les associations ou les manifestations sportives ; la prévention et l’intervention par des unités spécialisées dans le dialogue avec les jeunes ou par la police des mineurs lors de conflits dans l’espace public.
- Stalking
La police reçoit parfois de prétendues victimes, c’est-à-dire des gens qui, pour toutes sortes de raisons, affirment être harcelés par des stalkers alors qu’ils ne le sont pas du tout (False victimization syndrome). La plupart du temps, ces fausses allégations ne sont pas de la malveillance mais reposent sur de fausses idées ou de fausses perceptions. Il est toutefois difficile d’identifier les fausses accusations de stalking. Même si ce syndrome de la fausse victime est rare (environ 10 %), il est important de savoir qu’il existe.
Toutes les constellations de couples auteur-victime sont possibles. Mais le plus souvent, c’est un homme qui est le stalker et une femme la victime. Toutefois, il existe aussi des stalkers femmes ainsi que des stalkers hommes ou femmes qui harcèlent des personnes du même sexe. On considère cependant que les stalkers sont des hommes dans plus de 80 % des cas et que les victimes sont des femmes dans la même proportion.
Les stalkers sont majoritairement des hommes issus de toutes les classes sociales. Ils agissent le plus souvent seuls, même s’ils intègrent parfois l’environnement social de leur victime dans leurs activités. Les victimes sont en général des personnes avec lesquelles ils ont des relations privées ou professionnelles. Le harcèlement de victimes que l’auteur ne connaît pas personnellement constitue l’exception. Le plus souvent, les personnes traquées sont d’anciens partenaires de relations amoureuses. Mais des collaborateurs, des connaissances, des voisins, des fans ainsi que des clients peuvent devenir des stalkers, hommes ou femmes.
A ce jour, le stalking a encore été peu étudié en Suisse. Le nombre de victimes est donc difficile à évaluer. Dans une étude menée à Mannheim, 2000 personnes ont été interrogées sur leur vécu du stalking. Il en est ressorti qu’environ 12 % des participants avaient été au moins une fois dans leur vie victimes de stalkers. Elles ont raconté avoir été pendant longtemps poursuivies, harcelées ou menacées et avoir eu vécu dans l’angoisse. D’autres études évaluent à deux ans la durée moyenne pendant laquelle une victime est exposée aux actes d’un stalker.
Le stalking n’est pas un phénomène de masse. Il n’empêche que le nombre des victimes a sensiblement augmenté au cours de ces dernières décennies. Ceci peut s’expliquer par le fait que dans notre société, on attache une grande importance à l’individu et à ses besoins. Le nombre toujours croissant de divorces et de changements de partenaires peut aussi contribuer à cette évolution. Enfin, l’augmentation des cas de stalking est à mettre en relation avec le progrès technique. L’accès facilité aux moyens de communication avec les smartphones et Internet favorise le harcèlement tout en donnant aux gens l’impression de pouvoir davantage se permettre d’importuner des personnes, avec l’illusion de l’anonymat et la distance que permet la communication en ligne.
Outre une qualité de vie allant diminuant, les victimes souffrent d’un manque de confiance en soi, d’états d’angoisse, de troubles du sommeil, de maux de tête et de ventre, d’irritabilité, de dépression, de cauchemars, de méfiance accrue pouvant aller jusqu’à des crises de paranoïa. Les victimes se sentent également désemparées et désespérées car leur situation leur paraît sans issue. Avec le sentiment d’être constamment espionné et harcelé, même le propre logement de la victime ne constitue plus un environnement sûr. Les proches ne sont souvent même pas informés de ce qui se trame parce que la victime cherche à les protéger du stalker. De ce fait, elle s’isole du monde. Sa productivité souffre des entraves permanentes mises à son existence, elle renonce à des loisirs réguliers car elle craint de se trouver confrontée à son stalker.
Le stalking doit être pris au sérieux. Même si le stalking est perçu au début plus comme une intrusion désagréable dans la sphère privée que comme une menace dangereuse, les motivations du stalker qui semblent bienveillantes au commencement vont rapidement changer. La violence physique ou sexuelle est un moyen très répandu chez les stalkers pour atteindre leurs buts. Pourtant, même en l’absence de violences, les conséquences sont très graves pour les victimes : états d’angoisse, troubles du sommeil, maux de tête et d’estomac, irritabilité, dépressions et cauchemars n’en sont que quelques exemples. La raison pour laquelle les stalkers sont particulièrement dangereux, c’est qu’ils souffrent souvent d’une perception déformée, interprétant du coup incorrectement le refus de leur victime ou n’en ayant même pas du tout conscience.
- Armes
- En vertu de la loi sur les armes, les armes factices, les armes d’alarme et les armes soft air sont considérées comme des armes lorsqu’elles risquent d’être confondues avec des armes à feu.
- Les armes à air comprimé et les armes au CO2 sont également assimilées à des armes au sens de la législation lorsqu’il existe un risque de confusion ou lorsqu’elles développent une énergie à la bouche d’au moins 7,5 joules.
- Certains couteaux et autres objets dangereux destinés à blesser ainsi que tous les appareils à électrochocs et les sprays (à l’exception des sprays au poivre) figurent en outre parmi les armes interdites.
- Une arme soft air peut être prêtée en tant qu’arme de sport à une personne mineure pour autant que celle-ci puisse prouver qu’elle pratique régulièrement le tir, que rien ne donne à penser qu’elle utilisera l’arme de manière dangereuse pour elle-même ou pour autrui et qu’elle ne soit pas enregistrée au casier judiciaire.
- Une arme soft air est considérée comme une arme de sport lorsque le modèle en question est autorisé dans le cadre de compétitions nationales ou internationales.
- Le représentant légal du mineur ou la société de tir a 30 jours pour signaler le prêt au bureau des armes de son canton au moyen du formulaire correspondant.
Oui, pour autant que vous respectiez les règlements en vigueur. Il est notamment impératif de garantir l’identification du vendeur et la manipulation conforme de l’arme.
Non, la vente et l’acquisition d’armes factices, d’armes d’alarme ou d’armes soft air ne requièrent aucune autorisation particulière.
Le transport de cette arme est autorisé dans le cadre d’une participation à une manifestation de tir organisée dans un espace sécurisé.
Lors du transport d’une arme soft air, le chemin emprunté doit correspondre à l’itinéraire le plus court entre le domicile et le lieu de la manifestation de tir.
Les armes portées sans droit, par exemple par des personnes mineures ou dans un lieu public, peuvent être mises sous séquestre par les autorités compétentes.
S’il peut être établi qu’il existe un risque d’utilisation abusive, en particulier lorsqu’une personne a été menacée ou blessée avec l’arme en question, celle-ci peut être définitivement confisquée.
- L’introduction d’armes factices sur le territoire suisse à titre privé est soumise à autorisation. La demande de permis d’introduction d’armes à titre non professionnel est disponible sur le site Internet de fedpol.
- L’exportation définitive à titre privé nécessite une autorisation au sens de la loi sur le contrôle des biens. Ce document est délivré par le Secrétariat d’État à l’économie SECO.
- Toute personne souhaitant importer ce type d’arme sur le territoire suisse, ou au contraire l’exporter, requiert une patente de commerce d’armes autres que des armes à feu et une autorisation correspondante.
- Quiconque offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, répare à titre professionnel, modifie, porte ou introduit des armes sur le territoire suisse, sans droit, peut être puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus, ou d’une peine pécuniaire.
- Si l’auteur a agi par négligence, la peine est une amende. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut exempter l’auteur de toute peine.
- Est puni de l’amende au sens d’une contravention quiconque viole ses devoirs de diligence lors de l’aliénation d’armes, importe des armes sans autorisation, omet d’annoncer la perte d’une arme à la police ou utilise des formes d’offre interdites.
- Traite d'êtres humains
La Suisse est touchée au même titre que le reste de l’Europe. Elle ne fait pas exception. Les autorités de poursuite pénale ont mis au jour des cas de traite des êtres humains dans toutes les régions du pays.
La traite des êtres humains est une activité souterraine. Elle reste invisible pour la plupart des gens. Les trafiquants – exploitants de bordel ou souteneurs de femmes contraintes de se prostituer – se donnent beaucoup de peine pour camoufler qu’ils exploitent leurs victimes et font tout pour donner l’apparence qu’elles travailleraient de façon librement consentie. Les victimes sont menacées et exposées à des chantages pour qu’elles taisent leur situation réelle vis-à-vis des clients. De plus, de nombreuses victimes d’exploitation sexuelle vivent dans un grand isolement, les clients étant leurs seuls contacts avec l’extérieur. Cela vaut aussi pour les domestiques exploités par leurs employeurs. Ils ne fréquentent guère l’espace public ; dans de nombreux cas, ils n’ont même pas l’autorisation de quitter la maison.
Il ne faut pas croire non plus que la traite des êtres humains n’existe pas, simplement parce qu’aucun cas n’a été mis au jour dans sa ville ou dans son canton. Repérer ce type d’infraction et ses victimes requiert des connaissances fondées. Seuls les spécialistes sont capables de déceler les indices d’exploitation de certaines personnes lors de contrôles sur leur lieu de travail. Ceci dit, il arrive régulièrement que des non-spécialistes repèrent des personnes exploitées.
Eclairez votre entourage sur la problématique de la traite des êtres humains et du trafic de migrants et indiquez à vos proches et à vos connaissances où elles peuvent approfondir leurs connaissances sur ces sujets. Sensibilisez-les à la situation des victimes et expliquez-leur comment se comporter en cas de soupçon.
Oui. La plupart des personnes exploitées reçoivent périodiquement une rémunération modique pour leur travail et semblent s’accommoder de leur activité et de leur situation. Selon le Tribunal fédéral, il peut néanmoins s’agir de cas de traite des êtres humains dès lors que la personne est vulnérable et que l’employeur exploite cette vulnérabilité. Les personnes exposées dans leur pays d’origine à des conditions économiques et sociales précaires peuvent être considérées comme vulnérables. Ainsi, si un employeur octroie à une personne un salaire modeste pour la rendre docile et qu’il tire ainsi avantage de sa situation d’indigence manifeste dans le pays d’origine, il y a exploitation de cette personne, même si celle-ci s’accommode de son sort.
Le milieu de la prostitution est intéressant pour les personnes qui cherchent à tirer parti de la traite des êtres humains parce que les profits potentiels sont importants et que le risque d’une condamnation est faible.
S’il y a lieu de penser que la vie d’une victime de la traite des êtres humains est sérieusement menacée, la police doit en être avisée sans tarder (numéro d’appel 117). Pour les cas moins urgents, il existe en Suisse différentes organisations spécialisées dans l’aide aux victimes de la traite des êtres humains, plus particulièrement le Centre Social Protestant à Genève, l’Association de soutien aux victimes de traite et d’exploitation Astree à Lausanne et le Centre d’assistance aux migrantes et aux victimes de la traite des femmes (FIZ). Les personnes concernées et leurs proches peuvent aussi s’adresser au centre de consultation d’aide aux victimes d’infraction de leur canton.
La traite des êtres humains est un commerce lucratif. Beaucoup de criminels comptent s’enrichir en le pratiquant, car les profits potentiels sont importants et le risque d’être condamné est faible. En effet, les ressources mises à disposition de la poursuite pénale et de la prise en charge des victimes sont limitées et les preuves administrées devant les tribunaux ne sont souvent pas assez solides. En outre, les peines prononcées en Suisse en cas de condamnation sont relativement faibles en comparaison internationale.
La police doit compter sur la coopération des victimes et des témoins pour pouvoir agir efficacement contre les trafiquants et les obliger à répondre de leurs actes. Or, les traumatismes subis empêchent souvent les victimes de supporter une longue procédure judiciaire, ou elles craignent les actes de vengeance des malfaiteurs à leur encontre ou à l’encontre de leurs proches.
Avec la mondialisation, il est plus facile de s’informer sur les conditions de vie dans d’autres pays. La mobilité croissante et la multiplication des liaisons aériennes vers tous les pays du monde font que voyager est devenu moins cher. Un nombre croissant de personnes quittent ainsi leur pays. Elles tentent leur chance ailleurs, désireuses de se soustraire à la pauvreté, au chômage ou à l’absence de perspectives dans leur pays. Elles sont attirées par les pays qui semblent connaître une forte demande de main-d’œuvre non qualifiée bon marché.
Les pays d’Europe de l’Ouest ont durci leur politique en matière d’asile et à l’égard des réfugiés. De plus, immigrer légalement dans ces pays n’est plus une sinécure. C’est pourquoi les personnes qui souhaitent venir en Europe – de façon légale ou illégale – s’en remettent à des agences ou à des intermédiaires apparemment sérieux ou manifestement douteux. Elles réussissent souvent dans cette entreprise mais subissent ensuite l’exploitation par le travail.
Aux termes de la loi sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI), a droit à des conseils et à une aide toute personne qui a subi en Suisse, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle, quelle que soit sa nationalité ou son statut de séjour. En général, les victimes de la traite des êtres humains ont subi des violences psychiques et physiques et ont ainsi droit aux conseils et à l’aide LAVI. Les mesures sont adaptées à la situation de la victime : hébergement, encadrement et prise en charge pendant la période de stabilisation, et assistance médicale ou juridique. Les victimes de la traite des êtres humains doivent fréquemment être prises en charge par des services spécialisés au regard de leurs traumatismes.
Les victimes séjournent souvent illégalement en Suisse. Un délai de réflexion d’au moins trente jours leur est accordé avant leur expulsion. Pendant cette période, elles peuvent se régénérer et décider de dénoncer ou non pénalement les trafiquants. Le cas échéant, une autorisation de séjour peut leur être accordée pour la durée de la procédure d’instruction et de la procédure judiciaire à échéance du délai de réflexion. Une autorisation de séjour peut aussi être accordée au titre des cas individuels d’extrême gravité si des raisons s’opposent au retour dans le pays d’origine. Par ailleurs, la Suisse propose une aide au retour aux personnes concernées.
Le Centre d’assistance aux migrantes et aux victimes de la traite des femmes (FIZ) a émis des recommandations à l’intention des clients de prostituées :
- Utilisez votre téléphone mobile ! Permettez à cette personne de téléphoner à un service de conseil avec votre appareil.
- Alertez le FIZ au numéro de téléphone 044 436 90 00. Les conseillères du centre essaieront de la contacter et, si elle le souhaite, s’entretiendront avec elle dans sa langue maternelle (si possible).
- Donnez à cette personne le numéro de téléphone du FIZ et l‘adresse de son site Internet. Toutes ces publications sont disponibles en plusieurs langues (hongrois, roumain et thaï notamment).
- Menaces
Selon l’art. 180 du Code pénal, une menace peut être dénoncée aux autorités si la victime a été alarmée ou effrayée par la menace d’un préjudice grave. Le fait que l’auteur soit sérieux ou non n’importe pas pour que la menace soit punissable.
Lorsque des menaces sont commises dans un contexte de violences domestiques, l’auteur sera poursuivi d’office : a) si lui ou elle est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce ; abis) si l’auteur est le ou la partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire ; b) si l’auteur est le ou la partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise pendant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.
Le délit est poursuivi, que la menace ait été commise par des images, des écrits, des médias numériques ou encore par des gestes (par ex. des coups de feu en l’air). L’appréciation juridique tient également toujours compte du contexte d’ensemble.
Les gens ne devraient pas craindre d’alerter la police s’ils prennent la menace au sérieux, qu’ils ont peur et que sa mise à exécution aurait de graves conséquences. La menace la plus grave est la menace de mort et elle doit dans tous les cas être dénoncée si elle est prise au sérieux.
Les menaces anonymes sont particulièrement perfides. Ne connaissant pas leur auteur, les personnes visées ne peuvent clairement évaluer si elles sont sérieuses, ce qui ne fait qu’accroître la peur. La communication de menaces par les médias numériques a notamment pour caractéristique que la distance et l’anonymat présumé incitent à la désinhibition des personnes ayant des comportements asociaux. Dans un face à face, elles manifesteraient davantage de retenue. Les menaces proférées sur Internet sont également punissables et ces comportements lâches doivent être dénoncés, d’autant plus que les autorités de répression des délits ont souvent les moyens d’identifier les auteurs et de les rappeler à l’ordre.
D’une part, la police enquête sur les affaires de menaces simples et, d’autre part, la poursuite pénale doit toujours trancher si les menaces constituent de véritables avertissements pour le préjudice annoncé. Quelques cantons ont déjà mis sur pied ce que l’on appelle un dispositif (cantonal) de gestion des menaces. La gestion des menaces sert à identifier, évaluer et désamorcer des situations de menace ou de mise en danger. Il faut donc évaluer en cas de menaces si celles-ci constituent des signes avant-coureurs d’autres actes de violence ou s’il s’agit de menaces en l’air.
- Violence domestique
Thématique Violence sexuelle
- Violence sexuelle envers des adultes
L’Office fédéral de la statistique publie chaque année la Statistique policière de la criminalité. Elle renseigne sur les délits annoncés à la police. Il est également possible de consulter les jugements triés par articles du Code pénal. Les statistiques ne renseignent toutefois que sur la criminalité visible, c’est-à-dire sur les délits annoncés aux autorités. Comme les délits sexuels étant considérés comme honteux, ils ne sont souvent pas dénoncés et échappent aux recensements statistiques.
Les violences sexuelles envers les adultes englobent toutes les formes d’actes sexuels imposés et de comportements abusifs avec une composante sexuelle. Elles surviennent sous forme de harcèlement sexuel dans une relation de dépendance (p. ex. dans des rapports de travail), ou dans un rapport sexuel forcé au sein d’un couple marié ou entre partenaires. Outre la recherche de la satisfaction des besoins sexuels par la contrainte, les violences sexuelles s’accompagnent souvent de techniques d’intimidation, d’humiliation et de culpabilisation.
En cas d’urgence : appelez le plus rapidement la police en composant le 117.
Les mêmes conseils valent aussi bien pour les hommes que pour les femmes lorsqu’il s’agit de protéger leur intégrité physique dans l’espace public :
- Evitez le contact avec des personnes ivres ou sous l’influence de drogues ; une consommation excessive d’alcool ou d’autres psychotropes peut également être dangereuse, spécialement si l’on est seul en route ;
- Ne laissez pas votre boisson sans surveillance. Gardez un œil sur vos boissons, afin d’empêcher qu’une substance psychotrope y soit ajoutée à votre insu ;
- Si malgré tout vous êtes victime d’une agression : criez le plus fort possible, mordez, débattez-vous, donnez des coups de poing, des coups de pied ; la contre-attaque est le plus sûr moyen de se défendre avec succès contre une agression sexuelle.
Vous trouverez des informations pour protéger votre intégrité sexuelle en soirée à la page consacrée à notre campagne « Tu t’en sors ? ».
Entre adultes, les violences sexuelles peuvent aussi être le fait de personnes connues de la victime ; vous trouverez également des informations pour protéger votre intégrité sexuelle dans votre sphère privée à la page consacrée à la violence domestique.
Il est important que la victime d’un délit sexuel se fasse examiner le plus rapidement possible par un médecin spécialiste (<72h). Elle évitera absolument de nettoyer ou d’enlever toute trace avant l’examen, même si cela lui est très désagréable. La mise en sûreté des preuves médico-légales ne s’accompagne pas automatiquement d’un signalement à la police. C’est la victime qui en décide. Mais si elle décide ultérieurement de porter plainte, les éléments de preuve matériels conservés par les spécialistes sont mis à disposition des autorités compétentes. La mise en sûreté des preuves est d’une importance cruciale pour l’enquête. La victime de violences sexuelles peut contacter un centre de consultation pour l’aide aux victimes indépendamment du dépôt d’une plainte. Elle y reçoit un soutien juridique et psychologique, notamment en ce qui concerne la procédure d’enquête. En effet, la victime d’un délit sexuel dispose d’un certain droit à des informations et à une protection. La police et l’aide aux victimes la renseigneront en détail.
Dès qu’elle a connaissance d’un acte d’ordre sexuel, la police enquête d’office, sauf s’il s’agit de harcèlement sexuel qui constitue un délit poursuivi sur plainte. Elle ouvre les procédures suivantes dès le moment où il y a présomption d’un délit sexuel : sous la conduite du procureur compétent, elle réunit les preuves (p. ex. interrogatoire des personnes appelées à donner des renseignements et des témoins, analyses médico-légales, etc.). Ensuite de quoi une personne suspecte peut, le cas échéant, être mise en détention préventive, notamment s’il y a risque de fuite ou de récidive. Plus la police réunit de preuves, plus la procédure pénale devient supportable pour la victime.
Les déclarations de la victime d’un délit sexuel sont essentielles pour l’éventuelle condamnation de l’auteur·e de l’infraction, surtout s’il n’y a pas ou presque pas de preuves. À partir de l’âge de 15 ans, la victime est entendue comme témoin par un membre de la police du même sexe qu’elle. Elle peut se faire accompagner pour son audition par une personne de confiance (p. ex. une conseillère de l’aide aux victimes). Si la victime a moins de 18 ans au moment de l’ouverture de l’enquête pénale, elle est entendue au maximum deux fois. La deuxième audition n’a lieu que si elle est indispensable.
- Pornographie illégale
Ne téléchargez en aucun cas les photos et ne faites aucune capture d’écran. Vous vous rendez sinon coupable de téléchargement de pédopornographie !
Relevez l’adresse du site qui contient ces photos et envoyez-la au service de signalement en ligne contre la violence sexuelle envers les enfants et les adolescents.Selon un arrêt du Tribunal fédéral datant de 2005, la pornographie est définie de manière générale comme suit : « La notion de pornographie suppose d’une part que les représentations ou spectacles sont objectivement conçus pour provoquer chez le consommateur une excitation sexuelle. D’autre part, il est nécessaire que la sexualité à ce point extraite de son contexte humain et émotionnel que la personne concernée apparaisse comme un simple objet sexuel dont on peut disposer à volonté. Le comportement sexuel en devient grossier et mis en avant avec insistance. »
La loi désigne deux formes de pornographie qui, d’une manière générale, sont punissables : les représentations pornographiques avec des enfants et avec des animaux.
Adressez-vous à un centre de consultation spécialisé ou à un thérapeute. Vous trouverez des adresses de spécialistes reconnus sur le site de la Fédération suisse des Psychologues.
Les vidéos ou photos de pratiques sadomasochistes librement consenties ne sont en règle générale pas interdites. Les actes de violence dénoncés sont soumis à la libre interprétation du tribunal et sont évalués de cas en cas. Même si la pornographie avec des actes de violence n’est plus punissable, les représentations de la violence, y compris la pornographie, peuvent être dénoncées au titre de l’art.135 CP.
Non. Depuis la révision de septembre 2008 de la loi sur la protection des animaux, les rapports sexuels avec des animaux sont punissables.
Oui ! L’art. 197 CP dit explicitement que même des représentations d’actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs sont punissables. L’idée qui sous-tend cet article est que la consommation de pédopornographie peut induire des effets d’entraînement. La question de savoir si la représentation de mineurs est réelle ou seulement virtuelle ne joue par conséquent aucun rôle, sauf pour l’évaluation de la peine.
- Violence sexuelle envers des enfants
L’Office fédéral de la statistique publie chaque année la Statistique policière de la criminalité. Elle renseigne sur les délits annoncés à la police. Il est également possible de consulter les jugements triés par articles du Code pénal. Les statistiques ne renseignent toutefois que sur la criminalité visible, c’est-à-dire sur les délits annoncés aux autorités. Comme les délits sexuels étant considérés comme honteux, ils ne sont souvent pas dénoncés et échappent aux recensements statistiques.
La plupart des abus d’enfants sont commis par des proches de la victime. Les auteurs sont en général des membres de la famille au sens large, des amis de celle-ci, des enseignants ainsi que des entraîneurs sportifs que les enfants connaissent déjà. Les cas d’enfants enlevés par des auteurs qui leur sont totalement inconnus pour être ensuite abusés sexuellement sont extrêmement rares. Pourtant, beaucoup pensent à tort que ce très petit groupe d’auteurs inconnus constitue les pédocriminels « typiques ».
Une autre erreur d’appréciation revient fréquemment dans les débats : les gens pensent en effet que la plupart des personnes qui abusent d’enfants sont des pédophiles. Ce n’est pas le cas. Il existe de nombreux autres motifs. Curiosité perverse, crises personnelles, exercice du pouvoir par des moyens sexuels ou sadisme expliquent pourquoi des gens, en règle générale des hommes, abusent d’enfants. Les pédophiles sont des personnes qui se sentent exclusivement attirées sexuellement par des enfants. La pédophilie est donc à la fois une orientation sexuelle et un diagnostic psychiatrique. Elle n’a aucune conséquence pénale aussi longtemps que la personne ne donne pas suite à son attirance sexuelle. Ce n’est que lorsqu’elle commet des actes sexuels avec un enfant qu’elle se rend punissable.
La meilleure des préventions consiste à expliquer très tôt et toujours d’une façon adaptée à l’âge de l’enfant.
L’enfant doit savoir…
- … qu’il y a des gens qui peuvent être à la fois « gentils et méchants » ;
- … qu’il y a des gens qui, pendant un jeu, passent sans transition à l’abus ;
- … qu’il a le droit de dire « non » ;
- … qu’il n’est jamais responsable d’une agression sexuelle car c’est toujours l’adulte qui est responsable.
La peur est mauvaise conseillère et la confiance en soi est une protection efficace contre les agressions sexuelles ! Faites prendre conscience à votre enfant qu’il est une personne qui, jusqu’à un certain point, peut décider pour elle-même.
Dites à votre enfant que ce n’est pas lâche d’avoir peur, de prendre la fuite ou de chercher de l’aide. L’enfant doit se fier à son mauvais pressentiment ou à sa sensation de mal-être. Si, pour une raison quelconque, un enfant trouve une situation louche, il doit partir et aller vers des gens ou des lieux qu’il connaît.
Faites comprendre à votre enfant qu’il peut vous raconter tout ce qui lui arrive. Y compris les histoires qui lui paraissent étranges ou inquiétantes, ou encore celles qui sont arrivées parce qu’il n’avait pas obéi (p. ex. en empruntant un autre chemin pour aller à l’école). Prenez du temps pour parler avec votre enfant de ce qu’il vit et de ses soucis.
La ponctualité est une vertu : expliquez à votre enfant pourquoi il est important qu’il emprunte toujours le même chemin qui a été convenu pour aller à l’école et qu’il soit autant que possible à l’heure à la maison, à l’école, à la garderie, etc.
Manifestez votre intérêt et renseignez-vous sur tout ce qui pourrait être frappant. Intéressez-vous au cercle d’amis et de connaissances de votre enfant et à leurs activités communes. Interrogez votre enfant s’il ramène tout à coup de nouveaux objets à la maison, s’il parle de nouveaux amis sensiblement plus âgés que lui.
- Si malgré tout quelque chose s’est passé ou devait se passer, il est important de réagir de manière réfléchie. Si un enfant parle d’observations faites, d’expériences (désagréables), d’agressions, de menaces, etc., croyez-le et écoutez-le attentivement.
- Félicitez-le de s’être confié à vous. Ne le grondez pas s’il a fait quelque chose de faux. Sans quoi il n’osera plus rien vous confier.
- Annoncez ces observations concrètes ou expériences de votre enfant à la police. La police a besoin de connaître de tels signalements.
- Si votre enfant devait ne pas rentrer à l’heure habituelle, renseignez-vous sans tarder auprès de sa maîtresse ou de son maître et de ses amis. Si votre enfant demeure introuvable, adressez-vous sans tarder à la police en appelant le 117. La police prend chaque appel au sérieux et donne immédiatement suite à un appel.
- Violence sexuelle envers des adultes
Thématique Internet
- Cyberharcèlement
Le cyberharcèlement implique plusieurs auteurs qui s’en prennent à une personne pendant un certain temps via Internet ou via un smartphone dans le but délibéré de la blesser, de la menacer, de l’humilier ou de la harceler.
- La diffusion d’informations erronées et de fausses rumeurs
- La diffusion de photos ou de vidéos vexantes, falsifiées ou dénudées, voire pornographiques
- La fabrication de profils truqués (au contenu blessant)
- Le fait de proférer des injures, de harceler, de menacer et d’exercer un chantage par e-mail, SMS, etc.
- La création de « groupes de haine » dans le but de consigner des remarques négatives sur un individu, à la manière d’un livre d’or.
Le cyberharcèlement est toujours lié à un manque de compétences sociale et médiatique. Les auteurs manquent d’empathie pour la victime ou sont indifférents à ce qu’ils font. Les harceleurs renforcent leur position dans le groupe en rabaissant ou en insultant certains individus. Parfois, les auteurs profitent du manque de compétence médiatique de la victime, si celle-ci n’a pas pris les précautions requises pour gérer ses mots de passe, n’est pas suffisamment informée au moment de poster des photos, des vidéos ou d’autres contenus, ou ne s’est pas demandée qui serait susceptible de voir, de diffuser ou de faire un mauvais usage du matériel posté.
Le cyberharcèlement touche principalement les enfants et les jeunes et sa source est souvent l’école, ou en tout cas le monde non virtuel. Les harceleurs profitent de l’anonymat d’Internet pour masquer leur identité, mais ils font généralement partie des connaissances de la victime.
En encadrant les jeunes pour les aider à acquérir une compétence médiatique et en leur parlant du cyberharcèlement et de ses conséquences. Consulter à ce sujet les brochures « My little Safebook » et « Il était une fois … Internet ».
- Récoltez des preuves qu’une attaque de cyberharcèlement est en cours. Faites des captures d’écran de sites Internet, sauvegardez les fils de discussion dans les tchats et les SMS, enregistrez les noms d’utilisateur, etc.
- Parlez du cas de harcèlement avec le titulaire de classe et, le cas échéant,
avec le service social scolaire. Insistez pour que le titulaire s’active lui aussi, surtout si l’attaque provient des rangs de la classe ou de l’établissement de votre enfant. - Si l’attaque de cyberharcèlement ne cesse pas immédiatement après la discussion avec les jeunes concernés et leurs référents adultes, faites appel à de l’aide extérieure. Adressez-vous à un centre d’aide aux victimes ou à un service d’aide à la jeunesse de votre canton et évoquez avec ces experts s’il y a lieu de porter plainte à votre lieu de domicile ou s’il vaudrait mieux formuler une plainte pénale.
- Parlez avec votre enfant des conséquences du cyberharcèlement pour la victime et expliquez-lui quelles sanctions pénales peuvent frapper les auteurs de cyberharcèlement.
- Exigez qu’il cesse immédiatement de participer à des attaques de cyberharcèlement.
- Réfléchissez ensemble à la manière de s’excuser auprès de la victime et de réparer cette injustice.
- Si vous avez de bonnes raisons de penser que d’autres enfants ont participé à des attaques de cyberharcèlement ou que vous soupçonnez que votre enfant n’a pas cessé ses agissements, informez-en son titulaire de classe. Discutez avec lui des actions à engager.
Si un acte de cyberharcèlement se double d’extorsion et de chantage au sens de l’art. 156 CP ou de contrainte au sens de l’art. 181 CP, ces agissements sont poursuivis d’office par la police dès qu’elle en a connaissance. Indépendamment du fait que la victime souhaite ou non que les auteurs fassent l’objet d’une poursuite pénale !
Les infractions « plus légères » commises en lien avec le cyberharcèlement (injure selon l’art. 177 CP, p. ex.) ne sont poursuivies qu’à partir du moment où la victime (ou son représentant légal) porte plainte auprès de la police.
- Phishing
Ce terme est une contraction des mots anglais password (mot de passe), harvesting (moisson) et fishing (pêche). Il s’agit d’une technique d’escroquerie, aussi appelée hameçonnage, utilisée pour se procurer subrepticement les données confidentielles d’internautes. Les informations convoitées sont celles permettant par exemple d’accéder à ses comptes de messagerie, de services bancaires ou de la Poste en ligne ou de sites d’enchères. Les malfaiteurs agissent tantôt en bande organisée, tantôt en solitaire. L’attaque peut se produire par courriel, par un site web, par un service de téléphonie sur Internet (VoIP) ou par SMS.
Un mode opératoire courant consiste à envoyer des courriels aux cibles depuis l’adresse contrefaite d’un prestataire. Les escrocs misent sur la crédulité et la serviabilité de leurs victimes. Le faux courriel avertira par exemple le destinataire que ses informations de compte et ses données d’accès (nom d’utilisateur et mot de passe par ex.) ne seraient plus sûres ou seraient obsolètes. L’internaute y est sommé de cliquer sur un lien pour procéder aux modifications prétendument requises. Ce lien ne le dirigera pas vers le site du prestataire concerné mais vers une contrefaçon offrant souvent toutes les apparences de l’original.
A l’aide des données soutirées ou volées, les escrocs commettent ensuite des infractions contre le patrimoine au nom de la victime : virements bancaires, achats en ligne et même placements de fausses offres sur des sites d’enchères. De plus, l’escroc devient maître du compte de messagerie électronique dont il a soutiré les données d’accès. Il peut ainsi l’utiliser pour envoyer d’autres courriels frauduleux aux contacts de la victime, mais aussi le bloquer ou en modifier le mot de passe.
Les prestataires sérieux tels que banques, la Poste, sites d’enchères, autorités et institutions similaires ne vous demanderont jamais de divulguer vos mots de passe ou vos données de cartes de crédit par courriel ou au téléphone. Une extrême méfiance est donc de mise à l’égard de courriels qui vous réclameraient des données personnelles et affirmeraient que les conséquences en cas d’inexécution seraient une perte financière, une dénonciation pénale ou le blocage de votre carte de crédit par exemple.
- Les prestataires sérieux tels que banques, la Poste, sites d’enchères, autorités et institutions similaires ne vous demanderont jamais de divulguer vos mots de passe ou vos données de cartes de crédit par courriel ou au téléphone. Une extrême méfiance est donc de mise à l’égard de courriels qui vous réclameraient des données personnelles et affirmeraient que les conséquences en cas d’inexécution seraient une perte financière, une dénonciation pénale ou le blocage de votre carte de crédit par exemple. Ne répondez pas à ce genre de courriels. Effacez-les systématiquement sans cliquer sur les liens proposés.
- Installez un programme anti-hameçonnage et mettez-le à jour régulièrement.
- Avisez MELANI des attaques subies au moyen du formulaire ad hoc.
- Si vous avez divulgué des données confidentielles, contactez immédiatement le prestataire concerné (établissement financier, fournisseur d’accès ou service de messagerie électronique). Expliquez votre situation pour recouvrer le contrôle de vos données. Avisez aussi MELANI de l’attaque au moyen du formulaire ad hoc.
- Modifier immédiatement les mots de passe divulgués et assurez-vous que les nouveaux sont sûrs.
- Sextorsion
La sextorsion est une méthode de chantage exercée sur une personne à partir de photos ou de vidéos la montrant nue ou en train d’accomplir des actes sexuels (masturbation).
Ce terme anglais est la contraction des mots sex et extortion (terme qui désigne le chantage).
Le terme sexting est la contraction des mots anglais sex et texting (c’est-à-dire écrire un SMS). Il s’agit de l’envoi de selfies sexualisés ou de photos dénudées par SMS ou par MMS, dans un cadre privé. Par contre, la sextorsion désigne une forme d’arnaque utilisée par des associations de malfaiteurs pour faire chanter une personne au moyen de matériel photo ou vidéo qui la montre en train d’accomplir des actes sexuels.
Principalement sur les sites de rencontre en ligne et sur Facebook. Mais ces pratiques sont possibles sur tout réseau social.
Verser l’argent qu’on vous demande ne vous protègera pas. Rien n’empêche les malfaiteurs de publier quand même le matériel compromettant. En plus, ils n’en restent souvent pas là et risquent bien de vous demander encore plus d’argent.
Signalez-le à la plate-forme concernée et exigez la suppression immédiate des contenus à caractère sexuel. Activez une alerte Google personnalisée. Vous serez ainsi averti dès qu’une photo ou une vidéo à votre nom sera publiée sur Internet.
La sextorsion a toujours pour objectif de faire chanter une personne qui a été filmée. Le chantage et l’extorsion sont réprimés par l’art. 156 du Code pénal. Il s’agit de délits poursuivis d’office par l’autorité de poursuite pénale, pour autant qu’elle en ait connaissance.
N’entrez pas en matière sur les exigences des maîtres-chanteurs. Ne payez pas !
Rompez immédiatement tout contact avec la femme qui a servi d’appât et avec les maîtres-chanteurs. Supprimez-les de votre liste d’amis et ne réagissez à aucun message (courriels, SMS, etc.).
Si les maîtres-chanteurs ont publié du matériel photo ou vidéo, signalez-le sans tarder à la plate-forme concernée (Youtube, Facebook, etc.) et exigez que tout soit effacé.
Activez une alerte Google personnalisée. Vous serez ainsi averti dès qu’une photo ou une vidéo à votre nom sera publiée sur Internet.
Conservez toutes les preuves (matériel photo et vidéo utilisé pour vous faire chanter, coordonnées des maîtres-chanteurs et de l’appât, messages qu’ils vous ont envoyés – historique des conversations en ligne, courriels, etc. – informations sur les transactions) et avisez la police. N’ayez pas honte d’en parler : le rôle de la police n’est pas de juger vos actes mais d’agir !La grande majorité des victimes de chantages à la vidéo sexy sont des hommes, adolescents ou adultes.
N’acceptez jamais des propositions d’amitié ou de rencontre en ligne de personnes que vous ne pouvez pas identifier clairement ou que vous n’avez jamais rencontrées dans la vie réelle.
Ayez toujours à l’esprit que toute conversation par webcam est susceptible d’être enregistrée. Par conséquent, renoncez à tout acte qui pourrait vous mettre dans l’embarras.
- Piratage + logiciels malveillants
Les chevaux de Troie bancaires sont une famille de logiciels malveillants. Ils infectent les ordinateurs de manière ciblée. Leur but est de prendre le contrôle de sessions sur des plates-formes bancaires en ligne et d’effectuer à l’arrière-plan des virements vers des comptes en Suisse et à l’étranger.
Les logiciels espions, aussi appelés « mouchards » ou « espiogiciels » (en anglais : spyware), sont une famille de logiciels malveillants. Le programme permet de surveiller les activités de l’utilisateur sur les ordinateurs infectés (sites fréquentés par ex.). Ses données sont transmises à l’auteur de l’attaque par une connexion Internet.
Les rogues (en anglais : rogueware, ce qui signifie « logiciel fripouille », ou scareware, scare signifiant « effrayer ») sont une famille de logiciels malveillants. Il s’agit d’antivirus factices. Ils annoncent à la victime que son ordinateur serait prétendument infecté et affirment qu’il serait nécessaire, pour y remédier, d’acheter un logiciel supplémentaire, qui en réalité est lui-même malveillant.
Les logiciels de rançon, aussi appelés « rançongiciels » (en anglais : ransomware), sont une famille de logiciels malveillants qui cryptent les fichiers sur l’ordinateur de la victime et les autres terminaux du réseau partagé. Les personnes concernées ne peuvent alors plus utiliser leur ordinateur et l’accès à leur données personnelles est bloqué. Un écran verrouillé s’affiche. Il contient un message pressant la victime de payer une certaine somme aux pirates en utilisant une cybermonnaie (bitcoins par ex.) pour obtenir le rétablissement de l’accès à l’ordinateur et aux données bloquées. Le paiement avec une monnaie virtuelle complique le dépistage des auteurs de l’attaque. Il garantit l’anonymat de la transaction puisqu’il n’est pas nécessaire que son auteur et son bénéficiaire soient titulaires d’un compte bancaire. Céder au chantage ne garantit nullement que les pirates déverrouilleront les données après le paiement.
Lors d’attaques par téléchargement à la dérobée (en anglais : drive-by download), l’ordinateur est infecté lors de la consultation d’un site qui a été piraté. Les sites utilisés à cette fin par les escrocs peuvent être des sites tout à fait sérieux et très fréquentés.
L’attaque par déni de service distribué, aussi appelée « attaque DDoS » (qui est l’acronyme de distributed denial of service), vise à perturber l’accessibilité de systèmes informatiques. Une attaque DDoS peut être menée au niveau du réseau ou des applications, ou combiner les deux approches. Généralement, l’attaque est organisée au moyen d’un réseau de machines zombies (grand nombre de systèmes corrompus contrôlés à distance par l’agresseur) ou à des systèmes tiers mal configurés (résolveurs DNS ouverts par ex.). Des requêtes manipulées leur sont adressées de façon à générer des réponses volumineuses qui sont redirigées vers la cible de l’attaque. Ces attaques par amplification génèrent un volume de trafic si gigantesque que l’organisation visée n’est généralement pas en mesure d’y faire face sans aide extérieure. Dans la majorité des cas, les attaques DDoS relèvent de l’activisme politique, constituent une arme de chantage ou visent à nuire à un concurrent.
Un pare-feu personnel, des logiciels régulièrement mis à jour et l’installation d’un logiciel antivirus font partie des précautions techniques susceptibles d’augmenter notablement la sécurité de tout ordinateur. De plus, vos données ne devraient pas être stockées uniquement sur votre ordinateur. Sauvegardez-les régulièrement sur un support externe. En cas de suppression de vos données, vous pourrez ainsi en récupérer au moins une partie.
- Méfiez-vous des courriels qui proviennent d’une adresse inconnue.
- Ne cliquez jamais sur les pièces jointes et les liens qui vous sont proposés dans un courriel suspect.
- Ouvrez uniquement les fichiers et les programmes provenant de sources fiables et après passage au crible par un logiciel antivirus à jour.
- Ne répondez pas aux courriels indésirables (en anglais : spam) : vous révèleriez à l’expéditeur que votre adresse électronique est valable, ce qui l’inciterait à vous envoyer d’autres pourriels.
- Le mot de passe devrait se composer d’au moins huit caractères et contenir des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux.
- Optez pour un mot de passe facile à retenir. N’en gardez aucune trace écrite. Un bon mot de passe est une phrase complète combinant chiffres et caractères spéciaux (par ex. : « Je n’oub1ierai jamais ce m0t de p@sse !! »).
- Utilisez un mot de passe différent pour chaque usage (différents comptes d’utilisateurs par ex.). Il est vivement conseillé d’utiliser des mots de passe différents pour chaque service en ligne.
- Changez de mot de passe au plus tard quand vous soupçonnez qu’un tiers le connaît.
- Arnaque aux sentiments
- Money Mules
- Fraude à l’investissement sur Internet
- Cyberharcèlement
Thématique Escroquerie
- Arnaque
Arnaque est un terme familier que l’on peut aussi décrire comme une affaire conclue à un prix surfait. Dans la plupart des cas, une arnaque consiste à exiger d’une personne mal informée, dans des conditions opaques, qu’elle verse un montant excessif, voire simplement de l’argent, pour un conseil, un crédit, un abonnement ou un objet déterminé.
L’arnaque n’est pas une escroquerie et n’est donc pas illégale au sens du Code pénal. Pour qu’un comportement soit considéré comme frauduleux, il faut qu’il y ait eu dol, c’est-à-dire que la personne trompée n’ait en toute bonne foi pas pu se rendre compte que le marché ne correspondait pas à l’affaire présentée au départ. Or, dans le cas d’une arnaque, les personnes lésées auraient en principe eu la possibilité de s’informer sur les termes de l’affaire, même si les conditions à cet égard n’étaient pas idéales.
Il existe néanmoins toujours une zone grise entre l’escroquerie et l’arnaque. Quoiqu’il en soit, seul le tribunal peut déterminer si le méfait commis est une escroquerie ou une « simple » arnaque.
Les arnaqueurs ayant eux aussi bien compris l’intérêt des portails commerciaux sur Internet, ils créent sur la Toile des boutiques, qu’ils utilisent pour commercialiser des marchandises à des prix surfaits ou assorties de frais cachés. Il existe bien des manières d’arnaquer quelqu’un.
Au-delà des commandes indésirables ou des abonnements pièges, la facturation de frais supplémentaires est aussi une forme d’arnaque. Elle est particulièrement courante sur les magasins en ligne, qui affichent certes une adresse suivie de l’indication « .ch » sur Internet mais livrent votre marchandise depuis l’étranger, ce qui engendre des frais supplémentaires comme la TVA ou les frais de douane. Ces coûts supplémentaires ne figurent pas dans le calcul du prix initial et ne sont communiqués à l’acheteur qu’ultérieurement.
Il est donc impératif qu’un récapitulatif de la commande totale s’affiche avant la commande définitive d’un ou de plusieurs produits, pour permettre au client ou à la cliente de rectifier le tir. Les magasins en ligne contiennent parfois aussi des pièges sous forme d’abonnements ou de services de livraison réguliers auxquels des personnes souscrivent involontairement, sans en être informées.
Des entreprises peu sérieuses ou même frauduleuses du secteur financier essaient d’attirer de nouveaux clients en leur proposant des crédits qu’elles octroient en dépit d’éventuelles poursuites en cours, sans vérifier la solvabilité du débiteur et à des taux qui paraissent parfois très bas. De prime abord, ces offres semblent très prometteuses. Mais les apparences sont trompeuses. En Suisse, tous les instituts financiers sont tenus par la loi de vérifier la solvabilité d’une personne avant de lui accorder un crédit. En principe, une personne faisant l’objet de poursuites est considérée comme insolvable et ne peut donc pas obtenir de crédit. Tout établissement financier qui ne respecte pas ces dispositions peut être attaqué en justice.
Par itinérance, on entend l’utilisation de réseaux étrangers au moyen d’un téléphone mobile, d’une tablette ou d’un ordinateur portable. Les frais d’itinérance générés à l’étranger lorsque l’on surfe sur Internet depuis ces appareils peuvent très vite atteindre des sommes vertigineuses. De manière générale, la demande de roaming à l’étranger ne cesse d’augmenter, de nombreux utilisateurs et utilisatrices n’étant plus prêts à se passer des avantages conférés par un accès permanent à Internet via les téléphones mobiles, tablettes ou ordinateurs portables durant leurs vacances ou leurs déplacements professionnels à l’étranger. Voici trois consignes à respecter pour éviter d’alourdir inutilement sa facture personnelle de portable par des frais d’itinérance :
- Désactivez la fonction d’itinérance (données mobiles) sur votre portable lorsque vous vous rendez à l’étranger. Si vous n’avez pas besoin d’un accès permanent à Internet durant cette période, le plus simple est de désactiver cette fonction directement sur le portable ou de la faire bloquer par votre opérateur. Cela vous évitera de télécharger à votre insu des données onéreuses pendant votre séjour à l’étranger.
- Dans la mesure du possible, utilisez le wifi. Les hôtels, mais aussi les cafés ou les institutions publiques, offrent souvent à leur clientèle des réseaux wifi gratuits. N’oubliez pas que certains de ces réseaux sont moins sûrs que d’autres.
- Avant de partir, informez-vous sur les frais applicables dans votre pays de destination. Les frais de roaming ne sont pas identiques dans tous les pays.
Toute personne victime d’une arnaque peut déposer plainte auprès de la police ou du ministère public au motif de concurrence déloyale ou s’engager dans une voie de droit civil. Ces procédures sont toutefois longues et coûteuses et ne valent généralement pas la peine en regard du montant dû aux malfrats. S’adresser à la police peut néanmoins être utile, car elle apprécie souvent de connaître les différentes formes d’arnaque pratiquées et de pouvoir sensibiliser la population aux risques qui en découlent.
Il arrive régulièrement que des ménages suisses reçoivent de la part de cabinets d’avocats, soi-disant mandatés par le titulaire du droit concerné, des avis motivés par une prétendue violation de droit d’auteur. Dans la plupart des cas, l’objet des courriers est une facture prétendument impayée. Les victimes de ce type d’avis se voient par exemple reprocher d’avoir téléchargé illicitement de la musique ou des films sur Internet ou d’avoir posté sur leur blog des photos ne leur appartenant pas. Il convient de relever à cet égard qu’en Suisse le téléchargement de musique et de films utilisés à des fins personnelles n’est pas illégal en soi. De manière générale, les cabinets qui emploient ce genre de méthodes ont pour but de gagner un maximum d’argent – légalement ou non. Craignant de recevoir d’autres factures, de nombreuses personnes accusées ainsi préfèrent payer le montant exigé plutôt que d’engager des poursuites.
Les abonnements pièges sont également très prisés dans le domaine de la pornographie pour gagner facilement de l’argent. Les personnes qui surfent sur des sites pornographiques via leur téléphone portable peuvent ainsi s’abonner sans le savoir à un service érotique onéreux en cliquant sur une fausse bannière publicitaire renvoyant par exemple à une vidéo. S’ensuivent alors des SMS du fournisseur, qui connaît désormais le numéro de portable de l’internaute et encaisse les montants correspondants via la facture de téléphone de la victime, au moyen de WAP-Billing.
Lorsque l’on cherche un planificateur d’itinéraires en ligne sur Internet pour planifier un déplacement en voiture, on tombe parfois sur des sites douteux, comme par exemple routenplaner-maps.online. Il existe de nombreux sites de ce type qui se ressemblent et ont tous pour vocation d’inciter à contracter un abonnement piège. Avant de pouvoir calculer l’itinéraire à l’aide de cet outil, il faut indiquer son adresse électronique et accepter les conditions d’utilisation, qui ne sont toutefois affichées nulle part sur le site Internet. Ce n’est qu’une fois cette démarche effectuée que l’on peut véritablement utiliser l’outil de planification en ligne. Après s’être enregistrée, la personne reçoit du fournisseur un courriel exigeant le paiement du calculateur d’itinéraires. En général, le montant s’élève à une centaine d’euros pour un abonnement supposé s’étendre sur plusieurs mois.
Il n’est pas rare que des courriers indiquant que « Vous avez gagné » ou « Grand gagnant du mois d’août » soient envoyés à de prétendus lauréats de concours. En soi, il n’y a rien à redire contre des promesses de gain, pour autant qu’elles soient tenues, qu’elles ne supposent pas de contrepartie et que vous ayez effectivement participé à une loterie. La méfiance est toutefois de mise si l’heureux gagnant est prié d’aller chercher son gain, de fournir une contrepartie financière avant de le recevoir ou d’appeler un numéro payant.
Il arrive régulièrement que des malfrats se fassent de l’argent grâce à l’arnaque à l’annuaire. Dans ce type de combine, des travailleurs indépendants ou des petites PME sont invités, souvent par fax, mais parfois aussi par téléphone ou par courriel, à s’inscrire dans un annuaire (de la branche). Souvent, il s’agit de formulaires préimprimés sur lesquels figurent déjà les coordonnées de la personne ou de la société visée. Celle-ci est alors priée de vérifier si ces données sont exactes et de renvoyer le formulaire signé. En signant et en renvoyant le document, le signataire conclut effectivement un contrat avec l’arnaqueur par lequel il accepte prétendument de payer pour s’inscrire dans un annuaire « officiel ». Alors que l’offre a l’air gratuite, les détails en petits caractères indiquent que chaque entrée est payante.
- Escroquerie
Aux termes de la loi, est un escroc celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
En général, l’escroc fait croire à sa victime qu’il a un lien de parenté avec elle (petit-fils ou neveu p. ex.) puis prétend avoir besoin de l’aide de sa famille pour régler des problèmes financiers.
Le scénario est en général le suivant :- La victime reçoit un coup de fil d’une personne qui se comporte comme si elle avait un lien de parenté avec elle. Les escrocs sont très habiles : ils font parler leur victime de façon à ce que, sans s’en rendre compte, elle leur fournisse des informations sur le prétendu parent (nom, situation, etc.) dont ils se serviront ultérieurement dans la conversation. Typiquement, la première phrase d’un escroc au téléphone sera : « Bonjour Juliette ! Devine qui t’appelle ? ». La victime commencera à réfléchir et citera elle-même un nom, en révélant le lien de parenté (« Tu es Jérôme, non ? Le petit-fils de ma sœur ? »). L’escroc a alors le champ libre pour dérouler une histoire inventée de toutes pièces.
- L’escroc raconte une histoire compliquée pour accréditer l’idée qu’il aurait un besoin urgent d’argent. Le but est de faire en sorte que la victime se fasse du souci pour son prétendu parent et n’hésite pas à lui venir en aide rapidement.
- L’escroc demande un prêt. Préalablement, il aura essayé d’obtenir de la victime des informations sur la somme qu’elle serait en mesure de réunir. Les escrocs sont très habiles à ce jeu.
- L’escroc invente une deuxième histoire (compliquée également) pour justifier qu’il ne prendra pas réception de l’argent en mains propres. Il indique qu’une autre personne – une prétendue amie ou un collaborateur p. ex. – viendra chercher la somme chez la victime ou l’accompagnera à la banque.
- À la fin, les événements se précipitent : la victime apprend que l’argent doit être transmis immédiatement. En invoquant l’urgence, on insécurise complètement la personne, déjà (très) inquiète du sort de son soi-disant parent. Le but est d’empêcher qu’elle ne parle de l’affaire à des tierces personnes ou qu’elle prenne conseil auprès d’elles, ce qui pourrait l’amener à reconsidérer la situation.
- Méfiez-vous de toute personne qui vous appellerait et dont vous ne reconnaitriez pas immédiatement la voix. Si elle prétend avoir un lien de parenté avec vous, posez-lui des questions auxquels seul de vrais membres de votre famille sont en mesure de répondre.
- Ne citez jamais de nom de parents au téléphone. Si votre interlocuteur invoque une situation d’urgence, dites que vous avez besoin de réfléchir et raccrochez. Puis, appelez une personne de confiance dans votre famille et vérifiez les informations que l’on vous a données.
- Ne remettez jamais d’argent ou d’objets de valeur à un inconnu ! Si vous voulez faire un cadeau à un parent, donnez-le-lui toujours en mains propres.
- Ne donnez aucun renseignement sur les biens dont vous disposez à domicile ou sur vos comptes bancaires.
- Informez immédiatement la police de tout appel suspect (numéro 117).
- Il est important que les proches de personnes âgées ne publient ni ne transmettent à des tiers les numéros de téléphone de ces personnes (cela vaut aussi pour les maisons de retraite).
- Sensibilisez vos proches et vos connaissances sur le « coup du neveu ». Une carte postale d’information à ce sujet peut être commandée auprès de la police (« Faire confiance c’est bien, vérifier c’est mieux »).
Comme dans l’escroquerie à l’avance de frais, on fait miroiter un gain à la personne cible. Pour cela, il lui faut entrer dans un cercle de dons. Il s’agit d’une variante du jeu de l’avion qui fonctionne selon le principe de la vente pyramidale. Les personnes qui entrent dans le cercle font un don destiné aux adhérents plus anciens dans l’espoir de bénéficier elles-mêmes de dons de nouveaux membres ultérieurement. Le nouvel adhérent doit donc faire un dépôt. Les montants demandés peuvent s’élever à plusieurs centaines voire à plusieurs milliers de francs. Une fois admis dans le cercle, les membres participent régulièrement à des réunions lors desquelles ils sont mis sous pression pour les motiver à démarcher de nouveaux adhérents. Les cercles de dons s’effondrent comme des châteaux de cartes dès que le nombre de nouveaux participants à trouver devient trop important. La mise de départ est alors perdue. La participation à des cercles de dons et à la transmission en chaîne de lettres promettant des gains est interdite par la loi sur les loteries et les paris professionnels.
Est en principe considérée comme une fraude à la commission toute forme de fraude dans laquelle un paiement anticipé doit être versé en vue d’obtenir une somme d’argent, un produit ou une prestation. Les escrocs envoient des courriels dans lesquels ils expliquent de manière plus ou moins fantaisiste comment obtenir la somme d’argent, le produit ou la prestation en jeu. Une fois que la victime a payé l’acompte, les escrocs s’évanouissent dans la nature sans avoir la moindre intention de fournir la prestation promise en échange.
Les appels téléphoniques passés auprès de particuliers ou d’entreprises par des escrocs se faisant passer pour des employés de Microsoft ou d’autres entreprises de support informatique se multiplient au niveau mondial. En général, leurs auteurs prétendent appeler des Etats-Unis, de Grande-Bretagne ou d’Australie mais à leur anglais on reconnaît qu’ils ne sont pas anglophones. Ils utilisent un service de téléphonie sur Internet (voice over IP) – ce qui leur permet de falsifier ou de masquer leur numéro – ou appellent depuis l’installation téléphonique piratée d’une tierce personne. Ainsi, il est difficile de remonter jusqu’à eux ou de bloquer les numéros qu’ils utilisent.
Au téléphone, l’escroc prétend avoir reçu un message d’erreur concernant l’ordinateur de sa victime et que des problèmes de sécurité sont susceptibles de se poser. Il propose de les résoudre en sa prétendue qualité de collaborateur de Microsoft affecté à l’assistance technique. Pour l’aider, il doit pouvoir accéder à son ordinateur à distance. La victime est ainsi invitée à cliquer sur un lien que l’escroc lui a envoyé par courriel ou à télécharger un programme depuis une page web que l’escroc maîtrise (la technique est celle utilisée pour le phishing / hameçonnage). Dès que la victime s’exécute, l’escroc a accès à son ordinateur. Il peut alors surveiller les mots de passe saisis et consulter, supprimer, copier ou traiter à sa guise toutes les données sauvegardées sur l’ordinateur de sa victime.Le démarchage à domicile n’est pas en soi une activité malhonnête. Mais il arrive que la personne qui se présente sur le pas de la porte soit un escroc. Son but est de gagner beaucoup d’argent en vous proposant des affaires douteuses. Les escrocs ont souvent des comportements caractéristiques : ils insistent lourdement pour que le client les laisse entrer dans leur appartement où ils espèrent pouvoir l’enjôler plus facilement, sans être dérangés par d’autres personnes. L’escroc affirmera par exemple qu’il est un marchand ambulant, un rémouleur ou un marchand de tapis ou de vestes en cuir et qu’il est en mesure de proposer à sa victime des prix intéressants (pour un tapis persan d’une qualité exceptionnelle, p. ex.). Mais les produits vendus sur le pas de la porte sont souvent de la pacotille ou les prix proposés sont surfaits (produits d’hygiène corporelle ou articles ménagers, p. ex.). Les escrocs utilisent toujours les mêmes astuces :
- utilisation de noms d’entreprises qui inspirent confiance ;
- utilisation abusive de noms de marques connues ;
- utilisation d’emballages de produits tape-à-l’œil ;
- remise de prospectus contenant des recommandations de prix complètement surfaits ;
- promesse de longues garanties sur les produits ;
- la marchandise est vantée de manière très emphatique ;
- le sérieux du vendeur est invérifiable (les adresses sur les quittances et les cartes de visite remises sont souvent inventées de toutes pièces).
La révocation ne requiert pas de forme spéciale. L’envoi d’une lettre recommandée est la meilleure solution. Vous pourrez ainsi prouver la révocation. En principe, un contrat conclu lie les parties et est exécutoire. Le vendeur est censé informer le client par écrit de son droit de révocation (délai et forme) et lui communiquer son adresse. Le délai court à compter du moment où vous demandez ou acceptez le contrat. Si l’on ne vous informe pas du droit de révocation à la conclusion du contrat, le délai ne court qu’à partir du moment où vous apprenez l’existence de ce droit. Les prestations et marchandises (déjà) reçues doivent être restituées au vendeur.
Les personnes victimes d’une escroquerie devraient en aviser la police. Il n’y a pas de honte à avoir été dupé. Nul n’est à l’abri. Les escrocs utilisent parfois des procédés extrêmement subtils. Il est important que la police soit informée des escroqueries commises. Avisez-la même si la probabilité de recouvrer l’argent perdu est faible. Les tentatives d’escroquerie déjouées in extremis (« coup du neveu », p. ex.) devraient également lui être signalées immédiatement.
Ces informations permettent de repérer les régions particulièrement touchées et les procédés actuellement les plus utilisés. Les corps de police des cantons et des communes peuvent ainsi mettre en place une prévention ciblée et alerter les groupes de population particulièrement exposés, mais aussi augmenter leur présence dans les endroits où cela est nécessaire.
- Soyez attentif à l’orthographe des textes diffusés sur le site du magasin. L’un des premiers critères permettant de vérifier le sérieux d’un site Internet est l’orthographe. La présence de nombreuses erreurs reflète le manque de soin accordé à la publication du site Internet et, partant, le caractère négligent du vendeur à qui appartient le commerce. Une société sérieuse veillera en effet à ce que les textes publiés sur son site soient de bonne qualité.
- Vérifiez si le magasin en ligne concerné porte le label de qualité de l’Association Suisse de Vente à Distance (ASVAD) ou de Trusted Shops. Contrôlez également sur ces deux portails si le magasin en ligne a obtenu le label qualité à bon droit ou si l’utilisation du label figurant sur le site est abusive.
- Vérifiez soigneusement l’affaire incroyable qui vous est proposée. Renseignez-vous sur le vendeur et sur les éventuels frais supplémentaires comme les frais de douane ou la TVA. Même si Internet propose des offres intéressantes, aucun commerçant ne distribue sa marchandise gratuitement. La bonne affaire porte-t-elle sur un article original ou s’agit-il d’une contrefaçon ? Si le magasin en ligne vend effectivement des contrefaçons, signalez-le aux services compétents.
- Lorsque vous avez affaire à un commerçant inconnu, méfiez-vous si le paiement anticipé est la seule possibilité de paiement. En procédant ainsi vous payez la marchandise avant de l’avoir reçue. Les commerçants sérieux offrent toujours différentes modalités de paiement, comme le paiement par facture ou à la livraison, et le règlement par carte de crédit ou par PayPal.
- Le magasin en ligne indique-t-il l’adresse de contact du commerçant ? En Suisse, les vendeurs actifs dans le commerce électronique sont tenus en vertu de l’art. 3, al. 1, let. s LCD d’indiquer de manière claire et complète leur identité et leur adresse de contact. L’absence de mentions légales comportant l’adresse, l’adresse électronique et le numéro de téléphone du vendeur sur un site Internet est le signe que ce commerce est fallacieux. Si le vendeur travaille avec l’adresse électronique d’un fournisseur gratuit, son sérieux doit être mis en doute.
Les expressions anglaises Romance scam ou Love scam désignent un type de fraude à la commission sur Internet qui s’en prend à des personnes souhaitant ardemment trouver un partenaire. Cette arnaque est particulièrement sournoise parce qu’en plus de dépouiller une victime, elle la laisse le cœur brisé.
Sur des sites de rencontres et des réseaux sociaux, les escrocs se présentent, bien évidemment sous de fausses identités, comme des soupirants transis d’amour. Ils couvrent leur victime de compliments et de déclarations d’amour, avant de tenter de leur soutirer de l’argent en leur racontant des histoires à fendre le cœur.
- Ne versez jamais de caution via un service de transfert de fonds sans avoir au préalable reçu un contrat valable et visité l’objet à louer.
- Ignorez toute annonce immobilière concernant un appartement dont le propriétaire se trouve à l’étranger et exige un dépôt pour obtenir la clé et visiter l’objet en question.
- Ignorez toute annonce immobilière indiquant que le propriétaire (étranger) est prêt à vous remettre l’appartement contre une caution sans visite préalable.
- Ignorez toute annonce immobilière trop belle pour être vraie.
- Prenez contact avec le bailleur. Demandez des informations complémentaires ne figurant pas dans l’annonce. Un appel téléphonique permet de clarifier de nombreuses questions et de débusquer les éventuels escrocs.
- Si vous souhaitez réserver un appartement de vacances en dehors du site Internet, exigez du bailleur un contrat de location. Lisez soigneusement le bail avant de le signer. Veillez en outre à ce que chaque bailleur puisse définir lui-même ses conditions de paiement et de remboursement.
- Choisissez un mode de paiement sécurisé. Utilisez le service de paiement proposé par le site Internet concerné.
- Ne payez jamais à l’avance ni par le biais de services de transfert d’argent comme Western Union ou Moneygram.
- Lisez attentivement les commentaires concernant l’appartement à louer que vous convoitez et assurez-vous de leur crédibilité.
- Soyez méfiant face à des annonces pour des véhicules qui sont trop belles pour être vraies. Les caractéristiques typiques des tentatives d’escroquerie dans ce domaine sont les suivantes :
- le prix est incroyablement alléchant ;
- certaines indications de l’annonce concernant le véhicule ou le vendeur manquent ou sont incomplètes ;
- le modèle vendu est très rare ou est un objet de collection ;
- la conclusion de la vente doit se faire très rapidement (par ex. « offre valable encore jusqu’à demain ») ;
- les illustrations du véhicule ne sont pas des photos « authentiques », mais des images de catalogue ;
- le véhicule ou le vendeur se trouve (prétendument) à l’étranger ; et surtout
- un acompte doit être versé alors que vous n’avez ni vu ni testé le véhicule.
- Si vous avez l’impression qu’il s’agit d’une annonce frauduleuse, ne prenez pas contact avec le vendeur ou rompez immédiatement tout contact.
- Ne versez en aucun cas un acompte, surtout si vous devez passer par un service de transfert de fonds comme Western Union ou Moneygram.
- Pour payer un véhicule acheté en ligne, utilisez un mode de paiement proposé sur le site Internet ou concluez l’affaire par l’intermédiaire de la plateforme.
- N’envoyez pas de copies de documents personnels comme le passeport, la carte d’identité, le permis de conduire ou la carte grise au vendeur, même s’il vous le demande. Les malfrats peuvent utiliser ces documents pour d’autres escroqueries.
- Dénoncez les offres frauduleuses publiées sur la plateforme de vente en ligne.
- Soyez méfiant face à des annonces pour des véhicules qui sont trop belles pour être vraies. Les caractéristiques typiques des tentatives d’escroquerie dans ce domaine sont les suivantes :
En envoyant des faux courriels d’appel à l’aide, les malfrats visent avant tout à s’emparer des comptes de courrier électronique de tiers pour adresser en leur nom une demande d’aide financière à toutes les personnes figurant dans leur carnet d’adresses.
Dans ce type de fraude, les escrocs se servent d’abord du piratage ou du phishing, aussi appelé hameçonnage, pour prendre le contrôle du compte de courrier électronique d’une personne. Leur but est alors de récupérer tous les contacts du carnet d’adresses puis d’envoyer à chacun d’entre eux un courriel d’appel à l’aide. Dans ce message, les fraudeurs inventent une situation d’urgence, en expliquant par exemple que le prétendu contact se trouve en vacances ou en déplacement à l’étranger et vient de se faire voler non seulement tout son argent, mais aussi ses documents de voyage, et se retrouve donc sans le sou. À la fin du courriel, la personne demande alors de l’aide à ses contacts et sollicite un certain montant pour pouvoir payer le billet de retour et/ou la note d’hôtel. Faute de régler ces factures, la personne en détresse ne pourra pas rentrer chez elle. Les escrocs prient avec insistance les contacts de virer l’argent par l’intermédiaire d’un service de transfert de fonds. Dès que l’argent a été versé, on n’entend plus parler de l’auteur du message et l’argent s’est volatilisé.
Les personnes victimes d’une escroquerie ne devraient pas avoir honte d’en aviser la police. Les escrocs utilisant parfois des procédés extrêmement subtils, nul n’est à l’abri. Il est très important de signaler à la police les escroqueries commises, même si la probabilité de recouvrer l’argent perdu (surtout lors de fraudes en ligne) est faible. À noter que les personnes qui échappent in extremis à la manœuvre de tromperie d’un escroc devraient elles aussi s’adresser immédiatement à la police, car la tentative d’escroquerie en soi est également punissable.
Même si, comme nous l’avons dit, la police n’a que très peu de chance de pouvoir enquêter sur ces délits et identifier les personnes qui tirent les ficelles puisque tout se fait dans l’anonymat le plus complet, il est important de les dénoncer. En effet, les informations fournies permettent à la police de mesurer l’ampleur des arnaques, d’établir des liens avec d’autres plaintes et, éventuellement, de trouver des moyens d’enquêter. La police peut en outre déterminer les astuces utilisées pour induire les gens en erreur. Grâce aux connaissances acquises, les corps de police cantonaux et municipaux peuvent cibler la prévention et adresser des mises en garde aux groupes sociaux particulièrement menacés par ces délits.
Pour cela, il faut conserver les moyens de preuve : captures d’écran des faux comptes utilisés, enregistrements des conversations et/ou des courriels échangés. Les plaintes peuvent être déposées auprès de la police cantonale.
- Skimming
Le terme « skimming » est dérivé du verbe anglais to skim qui signifie « écrémer ». Dans ce genre de fraudes, les malfaiteurs apportent des modifications à une machine à cartes (bancomats, distributeurs automatiques de billets et terminaux de paiement de commerces tels que magasins, stations-service et restaurants) : des équipements spéciaux permettant de copier les données contenues sur la piste magnétique de la carte et d’espionner la saisie du code NIP sont apposés à la machine ou introduits dans celle-ci. Les informations volées permettent aux malfaiteurs de prélever subrepticement de l’argent sur le compte du titulaire. La plupart des victimes ne constatent le pillage que lorsqu’elles reçoivent leur relevé de compte.
- Des équipements spéciaux permettant de copier les données contenues sur la piste magnétique de la carte et d’espionner la saisie du code NIP sont d’abord apposés à une machine à cartes ou introduits dans celle-ci. Un dispositif de lecture copie les données contenues sur la piste magnétique et les malfaiteurs espionnent la saisie du code NIP grâce à une mini-caméra ou un clavier factice installé préalablement. Ces altérations sont quasiment indétectables pour le titulaire de la carte : les équipements spéciaux paraissent plus vrais que nature et la caméra utilisée est minuscule.
- Les escrocs produisent ensuite une contrefaçon de la carte avec les informations volées. Elle est inutilisable en Suisse car elle n’est pas assortie d’une puce électronique. Les malfaiteurs essaieront donc de retirer autant d’argent que possible depuis l’étranger.
- Certains auteurs d’attaques de skimming ne recherchent qu’à faire commerce des informations volées. Ils revendent les données contenues sur la piste magnétique et le code NIP sur Internet à d’autres escrocs. Les receleurs procéderont à des prélèvements illégaux sur le compte du titulaire de la carte depuis l’étranger.
- Ne divulguez en aucun cas votre code NIP à des tiers.
- Composez votre code NIP à l’abri des regards, quel que soit l’automate. Pendant la saisie, cachez le clavier avec une main ou votre portefeuille et assurez-vous de ne pas être observé.
- Ne vous laissez pas distraire lorsque vous retirez des espèces, réglez une facture ou achetez un billet. Demandez aux personnes qui ne se tiennent pas à distance de s’éloigner. Ne vous laissez pas entraîner dans une conversation et refusez toute aide d’inconnus (si votre carte est coincée dans l’automate par ex.).
- Faites confiance à votre intuition : si un distributeur vous paraît suspect ou que vous vous sentez mal à l’aise (parce que certaines personnes rôdent à proximité ou qu’un inconnu vous interpelle ou ne se tient pas à distance par ex.), interrompez la procédure et mettez-vous en quête d’une autre machine pour procéder au retrait ou au paiement.
- Ne confiez jamais votre carte à un tiers, même s’il prétend vouloir vous aider ou s’il s’agit d’un employé de l’établissement. La carte est susceptible d’être remplacée subrepticement en un tour de main.
- En cas de soupçon de fraude, faites bloquer votre carte immédiatement. Cela vaut aussi en cas de vol, de perte ou de non restitution de la carte par l’automate.
- Si vous constatez qu’un automate a été altéré, avertissez l’opérateur de l’appareil. En dehors des heures de bureau, alertez la police (numéro d’urgence 117). Vous contribuerez ainsi à prévenir de nouveaux préjudices.
- Vérifiez régulièrement vos relevés de compte et contactez immédiatement votre institut bancaire en cas d’anomalie.
Faites usage des possibilités de restreindre l’utilisation de votre carte à l’étranger (card control). Voici les mesures les plus efficaces contre le skimming :
- Géoblocage ou géocontrôle : la carte ne peut être utilisée que dans certains pays.
- Ajustement de la limite de retrait : la limite est abaissée pour les retraits effectués à l’étranger.
- Combinaison : la limite est abaissée pour les retraits dans certains pays.
Les modalités de restriction de l’utilisation de la carte à l’étranger diffèrent selon l’institut bancaire. Les pays concernés varient également. Certains établissements décident des pays étrangers dans lesquels la carte peut être utilisée, d’autres laissent le choix à leur client. Pour davantage d’information, adressez-vous directement à votre établissement.
- Si vous constatez qu’un automate à cartes a été altéré, avertissez l’opérateur de l’appareil ou – en dehors des heures de bureau – la police (numéro d’urgence 117). Suivez les instructions de la police, ne touchez à rien et refusez l’aide d’inconnus jusqu’à son arrivée.
- Faites immédiatement bloquer votre carte en cas de perte, de vol ou de non restitution par l’automate, si vous soupçonnez une fraude ou s’il s’avère, après discussion avec votre institut bancaire, que votre compte a fait l’objet de prélèvements frauduleux.
- Déposez plainte auprès de la police en cas de vol de votre carte ou si votre institut bancaire vous le conseille en relation avec des transactions non autorisées.
- Arnaques par téléphone
- Arnaque
Thématique Cambriolage
- Cambriolage
Si l’auteur force une porte ou brise une vitre pour accéder aux lieux, on parle de vol par effraction. Si l’auteur trouve porte ou fenêtres ouvertes et qu’il peut mettre la main sur des biens sans faire usage de la force, on parle de vol par intrusion.
C’est de jour, la plupart du temps, que les cambrioleurs visitent appartements et maisons, lorsque leurs habitants sont au travail ou occupés ailleurs. A l’inverse, les locaux commerciaux, les bureaux ou les entrepôts sont plus souvent cambriolés la nuit, lorsque les lieux sont déserts.
Ils veulent agir ni vu ni connu. Aussi prennent-ils généralement la fuite dès qu’ils entendent ou voient une présence dans un lieu habité ou dans un local commercial.
Ils opèrent selon la loi du moindre effort. Etant donné que beaucoup de gens ne pensent pas suffisamment à la sécurité de leur logement, les cambrioleurs peuvent trouver une fenêtre ouverte à la cave ou une porte-fenêtre ouverte sur la terrasse (vol par intrusion). La plupart des effractions sont commises avec des outils simples, tels que tournevis ou burin, des objets faciles à glisser dans une poche.
Les personnes qui commettent des cambriolages ne sont pas toujours des hommes portant des vêtements sombres. Parmi les cambrioleurs se trouvent aussi des femmes, des jeunes et même des enfants. Ils portent des vêtements aussi banals que possible pour ne pas attirer l’attention. Les personnes susceptibles de planifier un cambriolage se font parfois remarquer par leur comportement, lorsqu’elles observent les alentours d’une habitation ou rôdent dans le quartier.
Les entretiens conseil sont l’occasion pour les experts de la police de se faire une idée d’un bien avant d’émettre des recommandations sur la manière d’améliorer la protection anti-effraction et à quels endroits de la maison ou de l’appartement elle est indiquée. Ces prestations de conseil sont gratuites dans la plupart des cantons.
- Fermez toujours votre porte à clé, même si vous ne vous absentez que quelques instants.
- Fermez les fenêtres et les portes donnant sur un balcon ou une terrasse. Pensez-y : une fenêtre basculée est une fenêtre ouverte ! Le cambrioleur l’ouvrira sans peine, avec un peu de dextérité et sans recourir à la force.
- Un des obstacles les plus efficaces pour dissuader les cambrioleurs est d’entretenir des relations de bon voisinage. Moins on se barricade, plus on a confiance dans les personnes qui vivent près de chez soi, plus on sera sûr qu’elles gardent un œil vigilant sur sa maison ou sur son appartement. Informez vos voisins quand vous partez en vacances. S’ils savent que les lieux sont inoccupés et qu’ils entendent des bruits dans votre appartement ou votre maison ou qu’ils voient de la lumière, ils penseront tout de suite à un cambriolage. Si vous êtes absent pour un certain temps, il faudrait que quelqu’un s’occupe de votre courrier, car une boîte aux lettres qui déborde signale que vous êtes en voyage.
Si vous surprenez un cambrioleur en flagrant délit, ne tentez surtout pas de le retenir, et encore moins de le maîtriser ! Ne vous faites pas repérer et appelez la police (117). Retenez le signalement des intrus, quel véhicule ils ont utilisé et dans quelle direction ils sont partis. Tentez de noter leur numéro de plaque minéralogique, mais faites attention de ne pas vous mettre en danger !
Vous risqueriez de faire disparaître de précieux indices sur les auteurs. Par ailleurs, vous attendrez l’arrivée de la police à l’extérieur de votre logement.
Le dépliant «Cambriolage: et maintenant?» fournit des informations sur le mode d’intervention de la police, assorties de cinq conseils pratiques pour aider les victimes à reprendre une vie normale.
- Cambriolage
Vol
- Vol
Le genre de butin, le mode opératoire et le « lieu de travail » sont très hétérogènes. Le profil même des voleurs peut varier du tout au tout : il peut s’agir d’hommes ou de femmes, d’adolescents et même d’enfants ; de personnes en complet, déguisées en artisan, vêtues d’habits de sortie ou équipées d’un sac dos, d’un attaché-case ou d’un landau ; de personnes qui donnent l’impression d’être ivres, troublées ou très serviables. Elles prétendront être des touristes de passage en Suisse ou avoir un lien de parenté éloigné avec le grand-père de leur interlocuteur.
- Utilisez uniquement des dispositifs de sécurité certifiés pour protéger votre bicyclette.
- Arrimez votre bicyclette à un objet ancré dans le sol (clôture, poteau, etc.) de façon à ce qu’elle ne puisse être désengagée et emportée.
- Il est possible de cadenasser ensemble plusieurs bicyclettes.
- Parquez votre bicyclette ou votre moto dans un local verrouillé ou surveillé si possible.
- Si vous transportez une bicyclette en voiture et que vous la disposez sur le toit ou le capot arrière, n’oubliez pas de la cadenasser.
- Notez le numéro de cadre, la marque et la couleur de votre bicyclette. Il est conseillé de l’enregistrer auprès d’un prestataire de services tel que Veloregister ou Velofinder.
Si en dépit des précautions prises, vous êtes victime d’un vol, avisez-en immédiatement la police ! Elle vous demandera le numéro de cadre de la bicyclette, sa marque/son modèle, sa couleur et le nom de votre assurance ménage. De plus, vous devrez produire une pièce d’identité valable. Les vols peuvent être annoncés en ligne dans douze cantons.
- Ne laissez entrer aucun inconnu dans votre appartement, spécialement si vous y êtes seul.
- Si l’on sonne à votre domicile, utilisez toujours l’entrebâilleur et regardez par le judas ou par la fenêtre pour connaître l’identité du visiteur sans devoir ouvrir (complètement) la porte.
- Si la personne prétend travailler pour la commune ou prétexte l’accomplissement de travaux sur mandat de la gérance de l’immeuble, exigez une pièce d’identité et renseignez-vous par téléphone auprès de la commune ou de la gérance. Attention : ne vous fiez pas au numéro de téléphone mobile que l’on vous remettrait sur le pas de la porte. Il pourrait s’agir du numéro d’un complice qui jouera le rôle de collaborateur de la commune ou de la gérance si vous appelez. Cherchez donc vous-même ce numéro de téléphone sur Internet ou dans l’annuaire. Et fermez la porte jusqu’à ce que vous ayez éclairci si la personne travaille vraiment sur mandat de la commune ou de la gérance.
- Au moindre doute, ne laissez pas entrer dans la maison la personne sur le pas de la porte. Il vaut mieux prendre le risque de paraître impoli ou méfiant que celui de se faire dévaliser. Au besoin, vous pourrez toujours vous excuser après coup ou convenir d’un nouveau rendez-vous avec l’artisan ou le représentant de la commune que vous avez rabroué.
- Portez votre porte-monnaie, votre smartphone et la clé de votre domicile dans une poche intérieure (avec fermeture si possible).
- Portez votre sac (fermé) du côté opposé au trafic, qu’il s’agisse d’un sac à main ou d’un sac à bandoulière.
- Ne sortez pas inutilement les objets de valeur de vos poches ou de votre sac et évitez de les exhiber.
- Faites-vous toujours accompagner lorsque vous faites des courses où de grosses sommes sont en jeu.
- Evitez les chemins mal éclairés et peu fréquentés.
- Ne résistez pas si l’on essaie de vous arracher des objets de valeur : vous pourriez vous blesser.
- les lieux fréquentés par les touristes et les voyageurs
- les lieux dans lesquels il est facile de se mêler aux clients de restaurants ou d’hôtels
- les lieux fréquentés par des personnes incapables de surveiller elles-mêmes leurs objets de valeur (homes, hôpitaux)
- les lieux d’exercice physique et de pratique sportive
- les lieux de fête et d’autres lieux où l’on a tendance à s’enivrer
En cas de découverte ou de saisie d’un bien volé, la police tentera de faire des recoupements à l’aide de ses bases de données et s’efforcera de restituer le bien à son propriétaire.
Il est important de signaler les vols à la police même si la probabilité de retrouver des objets de valeur dérobés à la tire ou à l’astuce est faible. Ces informations permettent de reconstituer les régions particulièrement touchées et les procédés actuellement les plus utilisés. Les corps de police des cantons et des communes peuvent ainsi mettre en place une prévention ciblée et alerter les groupes de population particulièrement exposés, mais aussi augmenter leur présence dans les endroits où cela est nécessaire.
- Vol
Ce site utilise des cookies. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies et sur la manière dont vous pouvez modifier vos paramètres, consultez notre politique de confidentialité : Déclaration de protection des données
